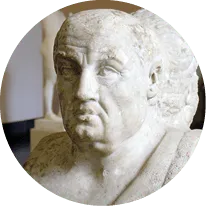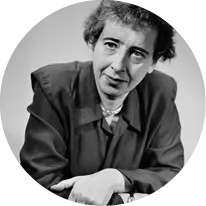Chapitre 3
Réflexion 3
Peut-on agir sur le temps ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 9Faire le bilan d'une vie
Dans nos vies ordinaires, nous ne vivons pas une durée qui nous appartient ; au contraire, nous
sommes embarqués dans des temporalités qui nous submergent et nous privent du présent.
C'est, au fond, ce que Sénèque déplore : le temps agit sur nous, bien plus que nous ne parvenons
à agir sur lui.
Fais un bilan, te dis-je, et repasse tous les jours de ta vie ; tu en verras fort peu,
à peine quelques déchets, qui soient restés à ta disposition. […] Chacun devance
sa propre vie : il se tourmente par désir de l'avenir et par dégoût du présent. Mais
celui‑ci qui met son temps tout entier à son service, qui organise toutes ses journées
comme une vie entière, ne souhaite ni ne craint le lendemain. Qu'est‑ce que
l'heure qui vient peut jamais lui apporter, en fait de plaisir neuf ? […] Sa vie, elle,
est maintenant en sûreté […] et une addition serait comme une nourriture qu'on
donnerait à un homme déjà rassasié et dont l'estomac est plein ; il la prend sans la
désirer. Aussi, si tu vois quelqu'un avec des cheveux blancs et des rides, ne va pas
penser qu'il a vécu longtemps : il n'a pas vécu longtemps, il a existé longtemps.
Iras‑tu dire qu'il a beaucoup navigué, l'homme qu'une affreuse tempête a poussé
çà et là dès sa sortie du port, et a fait tourner en rond sans changer de place, sous
le souffle alterné des vents déchaînés en tous sens ? Non, il n'a pas navigué beaucoup ; il a été beaucoup ballotté.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Que faudrait-il maîtriser pour cesser d'être « ballottés » dans nos existences ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 10Des œuvres pour résister au temps
Hannah Arendt nous invite ici à tourner notre regard vers deux types de produits fabriqués par
l'homme : les objets d'usage et les oeuvres d'art. Ils se distinguent des produits de consommation
et des produits de l'action, en ce qu'ils possèdent une certaine permanence temporelle.
a. Les objets d'usage désignent tout ce qui, du point de vue économique, forme le tissu réel, quotidien et matériel de notre existence.

 Moais Ahu Nau Nau, sur l'île de Pâques au Chili.
Moais Ahu Nau Nau, sur l'île de Pâques au Chili.
Parmi les choses qu'on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans
le monde fabriqué par l'homme, on distingue entre objets d'usagea et oeuvres
d'art ; tous deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire
à une immortalité potentielle dans le cas de l'oeuvre d'art. En tant que tels, ils se
distinguent d'une part des produits de consommation, dont la durée au monde
excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d'autre part, des produits
de l'action, comme les événements, les actes et les mots, tous en eux-mêmes si
transitoires qu'ils survivraient à peine à l'heure ou au jour où ils apparaissent au
monde, s'ils n'étaient conservés d'abord par la mémoire de l'homme, qui les tisse
en récits, et puis par ses facultés de fabrication. Du point de vue de la durée pure,
les oeuvres d'art sont clairement supérieures à toutes les autres choses ; comme elles durent plus longtemps au monde que n'importe quoi d'autre, elles sont les
plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n'avoir aucune
fonction dans le processus vital de la société ; à proprement parler, elles ne sont
pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à
la vie limitée des mortels, au va‑et‑vient des générations. Non seulement elles ne
sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des
objets d'usage : mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation
et d'utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine.
Aide à la lecture
a. Les objets d'usage désignent tout ce qui, du point de vue économique, forme le tissu réel, quotidien et matériel de notre existence.


Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Idéal / Réel
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quels exemples permettent de confirmer que les œuvres d'art résistent au temps ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 11Quitter le temps profane
Le temps sacré est une forme d'éternité que le croyant peut rejoindre le temps des rites.
a. Le rite réactualise, chaque année, un événement sacré qui ne s'est pas déroulé dans un passé daté, mais dans un temps mythique, toujours présent grâce à la commémoration rituelle.
Pas plus que l'espace, le Temps n'est, pour l'homme religieux, homogène ni
continu. Il y a les intervalles de Temps sacré, le temps des fêtes (en majorité, des
fêtes périodiques) ; il y a, d'autre part, le Temps profane, la durée temporelle
ordinaire dans laquelle s'inscrivent les actes dénués de signification religieuse. […]
L'homme religieux vit ainsi dans deux espèces de Temps, dont la plus importante,
le Temps sacré, se présente sous l'aspect paradoxal d'un Temps circulaire, réversible
et récupérable, sorte d'éternel présent mythique que l'on réintègre périodiquement
par le truchement des ritesa. Ce comportement à l'égard du Temps suffit à
distinguer l'homme religieux de l'homme non-religieux : le premier se refuse de
vivre uniquement dans ce qu'en termes modernes on appelle le « présent historique » ; il s'efforce de rejoindre un Temps sacré qui, à certains, égards, peut être
homologué à l'« Éternité ».
Aide à la lecture
a. Le rite réactualise, chaque année, un événement sacré qui ne s'est pas déroulé dans un passé daté, mais dans un temps mythique, toujours présent grâce à la commémoration rituelle.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.


Eliade - XXe siècle
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Transcendant / Immanent
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
La religion est-elle une façon d'agir sur le temps ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
À la lumière des textes du texte 10 et du texte 11, répondez à cette question : d'où peut venir l'émotion internationale suscitée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille