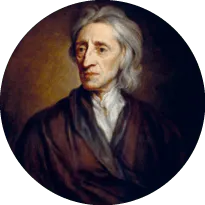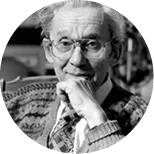Chapitre 1
Réflexion 2
Comment se définit notre identité ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 5Identité et mémoire
Texte fondateur
Locke thématise la question de l'identité personnelle qu'il lie à la notion de conscience. En effet, pour expliquer qu'une personne qui change constamment reste la même, il montre que c'est à la mémoire, conçue comme étant la capacité à repenser à nos actions et à nos expériences passées, que nous devons notre identité, notre Moi.
Cela posé, pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle, il faut voir ce
qu'emporte le mot de personne. C'est, à ce que je crois, un être pensant et intelligent,
capable de raison et de réflexion, et qui se peut consulter soi‑même comme
le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents
lieux ; ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions,
lequel est inséparable de la pensée. […]
Car, puisque la conscience accompagne toujours la pensée, et que c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même, et par où il se distingue de toute autre chose pensante : c'est aussi en cela seul que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même. Et aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne : le soi est présentement le même qu'il était alors ; et cette action passée a été faite par le même être qui se la représente actuellement par la réflexion.
Car, puisque la conscience accompagne toujours la pensée, et que c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même, et par où il se distingue de toute autre chose pensante : c'est aussi en cela seul que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même. Et aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne : le soi est présentement le même qu'il était alors ; et cette action passée a été faite par le même être qui se la représente actuellement par la réflexion.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Le « je » n'est-il qu'une mémoire ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 6L'identité personnelle :
une manière de se raconter ?
Ricœur s'oppose ici à l'analyse que Locke fait de l'identité personnelle : ce n'est pas le support de
toutes nos actions qui resterait le même malgré les différences, mais la manière même de nous
raconter qui nous donne une identité. Il existe donc un récit de notre personnage qui intègre
notre être et les événements qu'il vit ou se remémore.
a. Habituellement, le « je » est le sujet d'un récit. Ici toutefois, il s'agit de le comprendre comme étant aussi l'objet que le récit fabrique.
b. La mise en intrigue est la fabrication de la trame d'un récit. S'il y a transfert sur le personnage, cela signifie que c'est le personnage qui se constitue par la façon dont il se raconte.
[L]'opération narrative développe un concept tout à fait original d'identité
dynamique, qui concilie les catégories mêmes que Locke tenait pour contraires
l'une à l'autre : l'identité et la diversité. Le pas décisif en direction d'une conception
narrative de l'identité personnelle est fait lorsque l'on passe de l'action au
personnage.a Est personnage celui qui fait l'action dans le récit. La catégorie du
personnage est donc elle aussi une catégorie narrative et son rôle dans le récit
relève de la même intelligence narrative que l'intrigue elle-même. La question est
alors de savoir ce que la catégorie narrative du personnage apporte à la discussion
de l'identité personnelle. La thèse ici soutenue sera que l'identité du personnage se comprend par transfert sur lui de l'opération de mise en intrigue d'abord
appliquée à l'action racontée ; le personnage, dirons‑nous, est lui‑même mis en
intrigue.b
Aide à la lecture
a. Habituellement, le « je » est le sujet d'un récit. Ici toutefois, il s'agit de le comprendre comme étant aussi l'objet que le récit fabrique.
b. La mise en intrigue est la fabrication de la trame d'un récit. S'il y a transfert sur le personnage, cela signifie que c'est le personnage qui se constitue par la façon dont il se raconte.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Notre identité est-elle le récit dont nous sommes le personnage et l'auteur ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
L'effet Mandela
L'« effet Mandela » désigne les souvenirs partagés de
manière collective, mais erronés : l'expression vient de la
croyance répandue selon laquelle Nelson Mandela serait
mort en prison, alors qu'il a pourtant été président après
sa libération.
La psychologue contemporaine Elizabeth Loftus a montré que nos souvenirs pouvaient être modifiés par de nouvelles informations. Nous pouvons donc croire, de bonne foi, que des choses qui ne sont jamais arrivées font vraiment partie de nos vies. Si notre conscience peut accueillir de telles illusions, comment savoir que mes souvenirs me sont vraiment arrivés ? Or, si nous ne pouvons pas savoir avec certitude que nous sommes les auteurs de nos souvenirs, cette fragilité nous rend potentiellement vulnérables face à tous les auteurs de ces « faux souvenirs » : sectes, théories du complot et manipulateurs en tout genre.
La psychologue contemporaine Elizabeth Loftus a montré que nos souvenirs pouvaient être modifiés par de nouvelles informations. Nous pouvons donc croire, de bonne foi, que des choses qui ne sont jamais arrivées font vraiment partie de nos vies. Si notre conscience peut accueillir de telles illusions, comment savoir que mes souvenirs me sont vraiment arrivés ? Or, si nous ne pouvons pas savoir avec certitude que nous sommes les auteurs de nos souvenirs, cette fragilité nous rend potentiellement vulnérables face à tous les auteurs de ces « faux souvenirs » : sectes, théories du complot et manipulateurs en tout genre.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 7Autrui peut m'aider à
reconstituer mon identité
Leibniz soutient que les autres sont dépositaires de notre passé et qu'ils maintiennent notre
identité morale.
a. L'autre peut m'apprendre qui je suis sans que je me dédouble pour apprendre ce qu'est mon passé.
Ainsi, si une maladie avait fait une interruption de la continuité de la liaison
de conscienciosité, en sorte que je ne susse point comment je serais devenu dans
l'état présent, quoique je me souviendrais des choses plus éloignées, le témoignage
des autres pourrait remplir le vide de ma réminiscence. [...] Et si je venais à oublier
toutes les choses passées, et serais obligé de me laisser enseigner de nouveau jusqu'à
mon nom et jusqu'à lire et écrire, je pourrais toujours apprendre des autres ma
vie passée dans mon précédent état, comme j'ai gardé mes droits, sans qu'il soit
nécessaire de me partager en deux personnes, et de me faire héritier de moi‑même.a
Et tout cela suffit pour maintenir l'identité morale qui fait la même personne.
Aide à la lecture
a. L'autre peut m'apprendre qui je suis sans que je me dédouble pour apprendre ce qu'est mon passé.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Objectif / Subjectif / Intersubjectif
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Le récit que les autres font de moi est-il fiable ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
Cherchez des exemples de personnages de romans ou de films qui ont une identité qui ne correspond pas à la réalité.
Expliquez leurs troubles identitaires en vous appuyant sur les thèses du texte 5, du texte 6 et du texte 7.
Expliquez leurs troubles identitaires en vous appuyant sur les thèses du texte 5, du texte 6 et du texte 7.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 8La société, le regard de l'autre et l'identité
Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir cherche à analyser les rapports sociaux qui constituent
la féminité. Elle cherche à montrer que la féminité n'est pas donnée mais bien créée par
une conjonction de causes multiples qui définissent l'identité de la jeune fille, et par là aussi
celle de chaque individu.
a. Cette première phrase affirme fermement une thèse revendicative : Beauvoir s'oppose à l'idée que l'on est défini dès la naissance.
b. Ici, Simone de Beauvoir reprend des concepts à la psychanalyse freudienne, notamment la théorie des stades par lesquels l'enfant passe et ressent des plaisirs. Ces stades passent d'abord par deux phases communes – orale et anale – et ne se dissocient qu'à un âge avancé avec le stade des organes génitaux.
1. Homme dont on a coupé les parties génitales.
2. Activité de s'apprêter, de s'habiller, de se coiffer, etc. pour plaire aux autres. L'une des réflexions habituellement adressées aux femmes consiste à leur faire remarquer, voire à leur reprocher, qu'elles passent beaucoup de temps à s'occuper d'elles, activité considérée comme futile.
3. Moment où le petit d'un animal devient capable de se nourrir par ses propres moyens et de s'occuper de lui‑même. Ici, le miroir constitue un sevrage au sens figuré puisque c'est le moment où l'enfant se reconnaît comme individu différent de ses parents.
4. S'aliénant, devenir autre que soi (du latin alienus qui renvoie à l'étranger).
On ne naît pas femme : on le devient.a Aucun destin biologique, psychique,
économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ;
c'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le
mâle et le castrat1 qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut
constituer un individu comme un Autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant
ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons,
le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue
la compréhension du monde : c'est à travers les yeux, les mains, non par les parties
sexuelles qu'ils appréhendent l'univers. Le drame de la naissance, celui du
sevrage se déroulent de la même manière pour les nourrissons des deux sexes ;
ils ont les mêmes intérêts et les mêmes plaisirs ; la succion est d'abord la source
de leurs sensations les plus agréables ; puis ils passent par une phase anale où
ils tirent leurs plus grandes satisfactions des fonctions excrétoires qui leur sont
communes ; leur développement génital est analogue ; ils explorent leur corps
avec la même curiosité et la même indifférenceb ; […] ils ont la même jalousie
s'il naît un nouvel enfant ; ils la manifestent par les mêmes conduites : colères,
bouderie, troubles urinaires ; ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter
l'amour des adultes. Jusqu'à douze ans la fillette est aussi robuste que ses frères,
elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles ; il n'y a aucun domaine où il
lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si, bien avant la puberté, et parfois même
dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée,
ce n'est pas que de mystérieux instincts immédiatement la vouent à la passivité,
à la coquetterie2, à la maternité : c'est que l'intervention d'autrui dans la vie de
l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années sa vocation lui est
impérieusement insufflée. […] Il semble que ce soit à partir du moment où il saisit
son reflet dans les glaces – moment qui coïncide avec celui du sevrage3 – qu'il
commence à affirmer son identité : son moi se confond avec ce reflet si bien qu'il
ne se forme qu'en s'aliénant.4
Aide à la lecture
a. Cette première phrase affirme fermement une thèse revendicative : Beauvoir s'oppose à l'idée que l'on est défini dès la naissance.
b. Ici, Simone de Beauvoir reprend des concepts à la psychanalyse freudienne, notamment la théorie des stades par lesquels l'enfant passe et ressent des plaisirs. Ces stades passent d'abord par deux phases communes – orale et anale – et ne se dissocient qu'à un âge avancé avec le stade des organes génitaux.
Notes de bas de page
1. Homme dont on a coupé les parties génitales.
2. Activité de s'apprêter, de s'habiller, de se coiffer, etc. pour plaire aux autres. L'une des réflexions habituellement adressées aux femmes consiste à leur faire remarquer, voire à leur reprocher, qu'elles passent beaucoup de temps à s'occuper d'elles, activité considérée comme futile.
3. Moment où le petit d'un animal devient capable de se nourrir par ses propres moyens et de s'occuper de lui‑même. Ici, le miroir constitue un sevrage au sens figuré puisque c'est le moment où l'enfant se reconnaît comme individu différent de ses parents.
4. S'aliénant, devenir autre que soi (du latin alienus qui renvoie à l'étranger).
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Est-ce par le corps que l'on distingue les genres féminin et masculin ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
L'intersubjectivité et le regard


Le courant existentialiste considère que nous n'avons
pas une essence, une définition qui nous préexiste, mais
qu'on se définit à travers nos actes et dans la relation à
l'autre. Simone de Beauvoir reprend cette conception et
s'inspire également des concepts de la phénoménologie.
Dans son ouvrage majeur, Le deuxième sexe, elle explique que la femme se trouve aliénée. L'aliénation signifie qu'elle devient autre chose que ce qu'elle voudrait être en étant soumise au regard social qui la définit et la distingue de l'autre, en l'occurrence le masculin. Ainsi, le regard de l'autre nous impacte, change notre pensée et essaie de nous donner une définition que nous n'avons pas choisie. Ce regard est donc aliénant : je deviens étranger à moi‑même, car autrui me fait être quelque chose que je ne suis pas.
Par exemple, une petite fille est vue comme « coquette » ou « maternelle » car le cadre social, culturel et historique la renvoie vers ces caractéristiques, tandis qu'un petit garçon sera vu comme plus « énergique » et « moins propre » pour les mêmes raisons. Notre identité nous échappe donc dans une certaine mesure, car elle est constituée en partie par le regard d'autrui. Il s'agit du thème de l'intersubjectivité : je partage le monde avec d'autres points de vue qui l'interprètent et qui m'influencent.
Dans son ouvrage majeur, Le deuxième sexe, elle explique que la femme se trouve aliénée. L'aliénation signifie qu'elle devient autre chose que ce qu'elle voudrait être en étant soumise au regard social qui la définit et la distingue de l'autre, en l'occurrence le masculin. Ainsi, le regard de l'autre nous impacte, change notre pensée et essaie de nous donner une définition que nous n'avons pas choisie. Ce regard est donc aliénant : je deviens étranger à moi‑même, car autrui me fait être quelque chose que je ne suis pas.
Par exemple, une petite fille est vue comme « coquette » ou « maternelle » car le cadre social, culturel et historique la renvoie vers ces caractéristiques, tandis qu'un petit garçon sera vu comme plus « énergique » et « moins propre » pour les mêmes raisons. Notre identité nous échappe donc dans une certaine mesure, car elle est constituée en partie par le regard d'autrui. Il s'agit du thème de l'intersubjectivité : je partage le monde avec d'autres points de vue qui l'interprètent et qui m'influencent.
Cette influence d'autrui peut être comprise en analysant
la photographie ci-contre, qui saisit la réaction de
Goebbels – théoricien du nazisme et ministre de la propagande
du Troisième Reich – à l'instant où il apprend
que le photographe était juif. Le photographe Alfred
Eisenstaedt décrit qu'à peine quelques minutes auparavant,
Goebbels riait de bon cœur. Le regard qu'il lui jette
révèlerait la haine qu'il ressent pour cet individu qu'il ne
connaît pas. Il le réduit à un seul trait : l'ennemi.
Le photographe se retrouve défini dans un rôle que Goebbels lui confère, un rôle et une identité qu'il n'a pas choisis, mais qui le marquent. Il fuira l'Allemagne et les persécutions en 1935. La dimension intersubjective apparaît également : le photographe, par son cliché, donne une identité à Goebbels – celui qui porte la haine.
Finalement, le jeu des regards nous définit les uns les autres. Nous lisons dans le regard d'autrui ce qu'il pense de nous et nous nous trouvons confirmés ou infirmés dans nos espoirs d'être reconnus comme ceux que nous avons conscience d'être. Nous éprouvons cette intersubjectivité dans de multiples occasions, que ce soit dans une salle de classe ou dans les transports publics.
Le photographe se retrouve défini dans un rôle que Goebbels lui confère, un rôle et une identité qu'il n'a pas choisis, mais qui le marquent. Il fuira l'Allemagne et les persécutions en 1935. La dimension intersubjective apparaît également : le photographe, par son cliché, donne une identité à Goebbels – celui qui porte la haine.
Finalement, le jeu des regards nous définit les uns les autres. Nous lisons dans le regard d'autrui ce qu'il pense de nous et nous nous trouvons confirmés ou infirmés dans nos espoirs d'être reconnus comme ceux que nous avons conscience d'être. Nous éprouvons cette intersubjectivité dans de multiples occasions, que ce soit dans une salle de classe ou dans les transports publics.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
Dans sa pièce de théâtre Huis Clos, Sartre écrit : « L'enfer, c'est les autres ». À partir des éléments de la précision et du texte 8 :
1. Rédigez un paragraphe expliquant cette citation.
2. Recherchez les différents types de détermination qui peuvent définir l'identité de quelqu'un.
1. Rédigez un paragraphe expliquant cette citation.
2. Recherchez les différents types de détermination qui peuvent définir l'identité de quelqu'un.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille