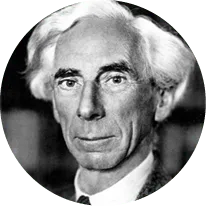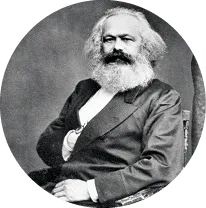Chapitre 9
Réflexion 2
Perd-on sa vie en travaillant ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 3Le travail fonde la propriété
Le travail n'est pas une perte de temps, mais une appropriation productrice de valeur. Il constitue le fondement du droit de propriété.
a. Le valet travaille pour son maître et le maître est propriétaire du résultat du travail du valet.
1. Ici, l'environnement naturel.
Encore que la terre et toutes les créatures inférieures soient communes et appartiennent en général à tous les hommes, chacun pourtant a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature1, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul : car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie, surtout, s'il reste aux autres assez de semblables et d'aussi bonnes choses communes […].
Ainsi, l'herbe que mon cheval mange, les mottes de terre que mon valet a arrachéesa, et les creux que j'ai faits dans des lieux auxquels j'ai un droit commun avec d'autres, deviennent mon bien et mon héritage propre, sans le consentement de qui que ce soit. Le travail, qui est mien, mettant ces choses hors de l'état commun où elles étaient, les a fixées et me les a appropriées.
Ainsi, l'herbe que mon cheval mange, les mottes de terre que mon valet a arrachéesa, et les creux que j'ai faits dans des lieux auxquels j'ai un droit commun avec d'autres, deviennent mon bien et mon héritage propre, sans le consentement de qui que ce soit. Le travail, qui est mien, mettant ces choses hors de l'état commun où elles étaient, les a fixées et me les a appropriées.
Aide à la lecture
a. Le valet travaille pour son maître et le maître est propriétaire du résultat du travail du valet.
Notes de bas de page
1. Ici, l'environnement naturel.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
En quoi la propriété, selon Locke, repose‑t‑elle sur le travail ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- En acte / En puissance
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 4Le travail produit l'estime de soi
Matthew B. Crawford est philosophe, professeur à l'université et, en parallèle à cette activité, réparateur de moto. Dans cet extrait, l'auteur propose une réflexion sur la valeur du travail manuel, et la satisfaction éprouvée au travail lorsque, plus jeune, il était électricien.
a. Au sein d'un travail utilitaire, l'exigence du « travail bien fait » peut conduire à une recherche de beauté.
Le moment où, à la fin de mon travail, j'appuyais enfin sur l'interrupteur (« Et la lumière fut ») était pour moi une source perpétuelle de satisfaction. J'avais là une preuve tangible de l'efficacité de mon intervention et de ma compétence. Les conséquences de mon travail étaient visibles aux yeux de tous, et donc personne ne pouvait douter de ladite compétence. Sa valeur sociale était indéniable. [...]
Ma spécialité, c'était plutôt les circuits d'immeubles résidentiels ou d'éclairage commercial basique, et le résultat de mon travail était généralement dissimulé à la vue, caché à l'intérieur des murs. Ce qui ne m'empêchait pas de ressentir une certaine fierté chaque fois que je satisfaisais aux exigences esthétiques d'une installation bien faitea. J'imaginais qu'un collègue électricien contemplerait un jour mon travail.
Et même si ce n'était pas le cas, je ressentais une obligation envers moi‑même. Ou plutôt, envers le travail lui‑même – on dit parfois en effet que le savoir‑faire artisanal repose sur le sens du travail bien fait, sans aucune considération annexe. Si ce type de satisfaction possède avant tout un caractère intrinsèque et intime, il n'en reste pas moins que ce qui se manifeste là, c'est une espèce de révélation, d'auto‑affirmation.
Ma spécialité, c'était plutôt les circuits d'immeubles résidentiels ou d'éclairage commercial basique, et le résultat de mon travail était généralement dissimulé à la vue, caché à l'intérieur des murs. Ce qui ne m'empêchait pas de ressentir une certaine fierté chaque fois que je satisfaisais aux exigences esthétiques d'une installation bien faitea. J'imaginais qu'un collègue électricien contemplerait un jour mon travail.
Et même si ce n'était pas le cas, je ressentais une obligation envers moi‑même. Ou plutôt, envers le travail lui‑même – on dit parfois en effet que le savoir‑faire artisanal repose sur le sens du travail bien fait, sans aucune considération annexe. Si ce type de satisfaction possède avant tout un caractère intrinsèque et intime, il n'en reste pas moins que ce qui se manifeste là, c'est une espèce de révélation, d'auto‑affirmation.
Aide à la lecture
a. Au sein d'un travail utilitaire, l'exigence du « travail bien fait » peut conduire à une recherche de beauté.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.


Crawford - XXe siècle
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quelles sont les satisfactions que le travail peut apporter ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 5Réduire le temps de travail
L'Éloge de l'oisiveté se présente comme un plaidoyer en faveur d'une réduction drastique du temps de travail qui produira des effets moraux.
1. La dyspepsie désigne un trouble digestif.
Quand je suggère qu'il faudrait réduire à quatre le nombre d'heures de travail, je ne veux pas laisser entendre qu'il faille dissiper en pure frivolité tout le temps qui reste. Je veux dire qu'en travaillant quatre heures par jour, un homme devrait avoir droit aux choses qui sont essentielles pour vivre dans un minimum de confort, et qu'il devrait pouvoir disposer du reste de son temps comme bon lui semble.
Le bonheur et la joie de vivre prendront la place de la fatigue nerveuse, de la lassitude et de la dyspepsie1. Il y aura assez de travail à accomplir pour rendre le loisir délicieux, mais pas assez pour conduire à l'épuisement […].
Les hommes et les femmes ordinaires, deviendront plus enclin à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspicion. Le goût pour la guerre disparaîtra, parce que celle-ci exigera de tous un travail long et acharné. La bonté est, de toutes les qualités morales, celle dont le monde a le plus besoin, or la bonté est le produit de l'aisance et de la sécurité, non d'une vie de galériens. Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi, à la place, le surmenage pour les uns et la misère pour les autres : en cela, nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment.
Le bonheur et la joie de vivre prendront la place de la fatigue nerveuse, de la lassitude et de la dyspepsie1. Il y aura assez de travail à accomplir pour rendre le loisir délicieux, mais pas assez pour conduire à l'épuisement […].
Les hommes et les femmes ordinaires, deviendront plus enclin à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspicion. Le goût pour la guerre disparaîtra, parce que celle-ci exigera de tous un travail long et acharné. La bonté est, de toutes les qualités morales, celle dont le monde a le plus besoin, or la bonté est le produit de l'aisance et de la sécurité, non d'une vie de galériens. Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi, à la place, le surmenage pour les uns et la misère pour les autres : en cela, nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment.
Note de bas de page
1. La dyspepsie désigne un trouble digestif.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Possible / Impossible
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quelles pourraient être les conséquences d'une baisse du temps de travail ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
Imaginez une société où l'on ne travaillerait que quatre heures par jour. Présentez à l'oral, et par groupes, quelles seraient vos activités le reste de la journée. Prenez en compte les questions suivantes : vos activités seraient‑elles nécessairement opposées à tout effort ? Ne nécessiteraient‑elles pas le travail d'autrui ?
Enregistreur audio
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 6Le « surtravail », temps de travail volé
Texte fondateur
Marx décrit ici le mécanisme de l'exploitation capitaliste : une partie du temps de travail de l'ouvrier n'est pas payée. Il s'agit du surtravail. Les profits des capitalistes sont une accumulation des plus‑values issues du surtravail des ouvriers.
En achetant la force de travail de l'ouvrier et en la payant à sa valeur, le capitaliste, comme tout autre acheteur, a acquis le droit de consommer la marchandise qu'il a achetée ou d'en usera. On consomme la force de travail d'un homme ou on l'utilise en le faisant travailler, tout comme on consomme une machine ou on l'utilise en la faisant fonctionner. Par l'achat de la valeur journalière ou hebdomadaire de la force de travail de l'ouvrier, le capitaliste a donc acquis le droit de se servir de cette force, de la faire travailler pendant toute la journée ou toute la semaineb. La journée ou la semaine de travail a, naturellement, ses limites, mais nous examinerons cela de plus près par la suite.
Pour l'instant, je veux attirer votre attention sur un point décisif.
La valeur de la force de travail est déterminée par la quantité de travail nécessaire à son entretien ou à sa reproductionc, mais l'usage de cette force de travail n'est limité que par l'énergie agissante et la force physique de l'ouvrier. La valeur journalière ou hebdomadaire de la force de travail est tout à fait différente de l'exercice journalier ou hebdomadaire de cette forced, tout comme la nourriture dont un cheval a besoin et le temps qu'il peut porter son cavalier sont deux choses tout à fait distinctes. La quantité de travail qui limite la valeur de la force de travail de l'ouvrier ne constitue en aucun cas la limite de la quantité de travail que peut exécuter sa force de travail. Prenons l'exemple de notre ouvrier fileur. Nous avons vu que pour renouveler journellement sa force de travail, il lui faut créer une valeur journalière de 3 shillings, ce qu'il réalise par son travail journalier de 6 heures. Mais cela ne le rend pas incapable de travailler journellement 10 à 12 heures ou davantage. En payant la valeur journalière ou hebdomadaire de la force de travail de l'ouvrier fileur, le capitaliste s'est acquis le droit de se servir de celle‑ci pendant toute la journée ou toute la semainee. Il le fera donc travailler, mettons, 12 heures par jour. En sus et au surplus des 6 heures qui lui sont nécessaires pour produire l'équivalent de son salaire, c'est‑à‑dire de la valeur de sa force de travail, le fileur devra donc travailler 6 autres heures que j'appellerai les heures de surtravail, lequel surtravail se réalisera en une plus‑value et un surproduitf. Si notre ouvrier fileur, par exemple, au moyen de son travail journalier de 6 heures, ajoute au coton une valeur de 3 shillings qui forme l'équivalent exact de son salaire, il ajoutera au coton en 12 heures une valeur de 6 shillings et produira un surplus correspondant de filé.
Pour l'instant, je veux attirer votre attention sur un point décisif.
La valeur de la force de travail est déterminée par la quantité de travail nécessaire à son entretien ou à sa reproductionc, mais l'usage de cette force de travail n'est limité que par l'énergie agissante et la force physique de l'ouvrier. La valeur journalière ou hebdomadaire de la force de travail est tout à fait différente de l'exercice journalier ou hebdomadaire de cette forced, tout comme la nourriture dont un cheval a besoin et le temps qu'il peut porter son cavalier sont deux choses tout à fait distinctes. La quantité de travail qui limite la valeur de la force de travail de l'ouvrier ne constitue en aucun cas la limite de la quantité de travail que peut exécuter sa force de travail. Prenons l'exemple de notre ouvrier fileur. Nous avons vu que pour renouveler journellement sa force de travail, il lui faut créer une valeur journalière de 3 shillings, ce qu'il réalise par son travail journalier de 6 heures. Mais cela ne le rend pas incapable de travailler journellement 10 à 12 heures ou davantage. En payant la valeur journalière ou hebdomadaire de la force de travail de l'ouvrier fileur, le capitaliste s'est acquis le droit de se servir de celle‑ci pendant toute la journée ou toute la semainee. Il le fera donc travailler, mettons, 12 heures par jour. En sus et au surplus des 6 heures qui lui sont nécessaires pour produire l'équivalent de son salaire, c'est‑à‑dire de la valeur de sa force de travail, le fileur devra donc travailler 6 autres heures que j'appellerai les heures de surtravail, lequel surtravail se réalisera en une plus‑value et un surproduitf. Si notre ouvrier fileur, par exemple, au moyen de son travail journalier de 6 heures, ajoute au coton une valeur de 3 shillings qui forme l'équivalent exact de son salaire, il ajoutera au coton en 12 heures une valeur de 6 shillings et produira un surplus correspondant de filé.
Aide à la lecture
a. Dans le système capitaliste, la capacité de travail de l'ouvrier est considérée comme une marchandise.
b. Une fois cette marchandise acquise contre un salaire, le capitaliste fait travailler l'ouvrier toute la journée.
c. Le prix payé pour la force de travail (sa valeur) équivaut à ce dont a besoin l'ouvrier pour reproduire sa force de travail.
d. Cependant, la valeur de la force de travail est distincte de celle produite par l'ouvrier.
e. Exploiter l'ouvrier, c'est le faire travailler plus que nécessaire : en un sens, c'est donc le faire travailler gratuitement pour une part de son temps.
f. Le surtravail est le temps supplémentaire qui permet au capitaliste de générer une plus‑value grâce aux richesses produites.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Obligation / Contrainte
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
En quoi le temps de travail de l'ouvrier est‑il un temps en partie volé ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Commentaire
Pour l'économie politique classique, la valeur d'échange d'un bien, c'est‑à‑dire sa valeur marchande, est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour le produire, que ce soit en termes de temps de travail socialement nécessaire, d'intensité ou de difficulté. Plus une marchandise demande de travail, plus sa valeur d'échange sera élevée. La valeur d'échange se distingue de la valeur d'usage, qui désigne l'utilité de la chose et qui est relative à un besoin. Si Marx reprend en partie cette théorie, il critique en revanche la tendance à faire du travail une simple marchandise et dénonce l'exploitation que cette prétendue « valeur travail » peut en réalité cacher.
Ainsi, l'ouvrier qui loue à son patron sa force de travail, c'est‑à‑dire sa capacité à travailler, reçoit un salaire. Ce dernier lui permet de reproduire sa force de travail, en satisfaisant ses besoins primaires (avoir de quoi manger, se loger, etc.) pour qu'il puisse retourner travailler. Cependant, l'ouvrier travaille plus que nécessaire : ce temps supplémentaire, durant lequel l'ouvrier n'est en réalité pas payé, est appelé « surtravail ».
Ce surtravail permet au capitaliste de générer une plus‑value. Cette dernière consiste donc à tirer un profit d'un travail non rémunéré : le capitaliste tire de la production une valeur supérieure à ce que lui coûte le travailleur.
D'un point de vue monétaire, la plus‑value devient un profit lorsque le produit est ensuite vendu. D'une part, elle peut s'accroître en allongeant la durée du temps de travail de l'ouvrier : on parle alors de plus‑value absolue. D'autre part, elle peut s'accroître par les transformations de l'organisation de la production, notamment en augmentant la productivité du travail : il s'agit alors d'une plus‑value relative. La productivité est le nombre d'objets produits en un temps donné.
Pour Marx, ce surtravail est le fondement de l'exploitation capitaliste. En effet, la classe dominante, la bourgeoisie, qui possède les moyens de production (usines, machines), exploite la classe dominée, salariée, en vue de son propre bénéfice. Elle constitue ainsi un capital servant de base à de nouveaux investissements qui renforcent l'exploitation des travailleurs.
Ainsi, l'ouvrier qui loue à son patron sa force de travail, c'est‑à‑dire sa capacité à travailler, reçoit un salaire. Ce dernier lui permet de reproduire sa force de travail, en satisfaisant ses besoins primaires (avoir de quoi manger, se loger, etc.) pour qu'il puisse retourner travailler. Cependant, l'ouvrier travaille plus que nécessaire : ce temps supplémentaire, durant lequel l'ouvrier n'est en réalité pas payé, est appelé « surtravail ».
Ce surtravail permet au capitaliste de générer une plus‑value. Cette dernière consiste donc à tirer un profit d'un travail non rémunéré : le capitaliste tire de la production une valeur supérieure à ce que lui coûte le travailleur.
D'un point de vue monétaire, la plus‑value devient un profit lorsque le produit est ensuite vendu. D'une part, elle peut s'accroître en allongeant la durée du temps de travail de l'ouvrier : on parle alors de plus‑value absolue. D'autre part, elle peut s'accroître par les transformations de l'organisation de la production, notamment en augmentant la productivité du travail : il s'agit alors d'une plus‑value relative. La productivité est le nombre d'objets produits en un temps donné.
Pour Marx, ce surtravail est le fondement de l'exploitation capitaliste. En effet, la classe dominante, la bourgeoisie, qui possède les moyens de production (usines, machines), exploite la classe dominée, salariée, en vue de son propre bénéfice. Elle constitue ainsi un capital servant de base à de nouveaux investissements qui renforcent l'exploitation des travailleurs.

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le revenu universel
Le revenu universel (appelé aussi revenu d'existence ou revenu de base) est une somme versée à tous les citoyens, sans condition, tout au long de leur vie. Au cours de l'histoire, l'idée d'un revenu universel a fait l'objet de nombreuses réflexions philosophiques, économiques et politiques. Ses objectifs sont multiples.- Question : Faut‑il instaurer un revenu universel ? Pour quelles raisons ?
- Objectif : Interroger la valeur du travail et la confronter à la valeur de l'existence. Il s'agit également d'analyser deux points de vue antagonistes sur le travail. Les partisans du revenu universel pensent que ce dernier permettrait d'instaurer un nouveau rapport au travail et au temps : les individus ne seraient plus forcés d'accepter une forme de surtravail ou de précarité. Pour les détracteurs, le revenu universel pose plusieurs problèmes. Comment le financer ? Quel montant accorder aux citoyens ? N'est‑ce pas pousser les individus à rester oisifs ? Y aurait‑il des contreparties à exiger, comme un service citoyen par exemple ?
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille