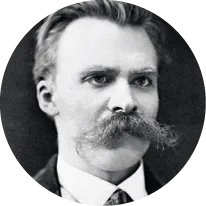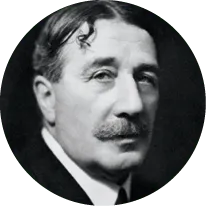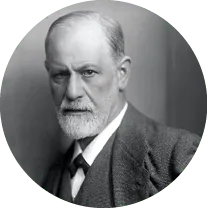Chapitre 2
Réflexion 1
Ma pensée est-elle toujours consciente ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 1Des pensées dont nous
ne sommes pas conscients
Alors que Descartes affirmait que la conscience peut se connaître clairement et distinctement
elle-même dès qu'elle s'y efforce, Leibniz affirme qu'il existe des petites perceptions dont nous
n'avons pas conscience, des pensées « sans aperception ni réflexion ».
a. Si une perception est sans aperception, c'est que nous n'en avons pas conscience.
b. L'harmonie de l'âme et du corps signifie que les affects de l'âme correspondent aux affects du corps.
c. « Des objets occupants » sont des choses qui concentrent l'intérêt et l'attention.
d. Il faut qu'un tiers intervienne sans attendre (incontinent) pour que le sujet prenne conscience d'une perception que l'oubli pourrait effacer.
e. De la même manière, lorsque l'on écoute un morceau de musique, on n'entend pas toutes les notes. Pourtant, elles existent pour former le morceau que l'on entend.
D'ailleurs il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité
de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexiona, c'est‑à‑dire
des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce
que les impressions sont trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en
sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles
ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans
l'assemblage. C'est ainsi que la coutume fait que nous ne prenons pas garde au
mouvement d'un moulin ou à une chute d'eau, quand nous avons habité tout
auprès depuis quelque temps. Ce n'est pas que ce mouvement ne frappe toujours
nos organes, et qu'il ne se passe encore quelque chose dans l'âme qui y réponde,
à cause de l'harmonie de l'âme et du corpsb ; mais les impressions qui sont dans
l'âme et dans le corps, destituées des attraits de la nouveauté, ne sont pas assez
fortes pour s'attirer notre attention et notre mémoire, qui ne s'attachent qu'à des
objets plus occupantsc. Toute attention demande de la mémoire, et quand nous
ne sommes point avertis pour ainsi dire de prendre garde à quelques-unes de nos
propres perceptions présentes, nous les laissons passer sans réflexion et même sans
les remarquer. Mais si quelqu'un nous en avertit incontinent et nous fait remarquer
par exemple quelque bruit qu'on vient d'entendred, nous nous en souvenons
et nous nous apercevons d'en avoir eu tantôt quelque sentiment. Ainsi c'étaient des perceptions dont nous ne nous étions pas aperçus incontinent, l'aperception
ne venant dans ce cas d'avertissement qu'après quelque intervalle, pour petit qu'il
soit. Et pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions
distinguer dans la foule, j'ai coutume de me servir de l'exemple du mugissement
ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est sur le rivage. Pour entendre
ce bruit comme l'on fait, il faut bien qu'on entende les parties qui composent ce
tout, c'est-à-dire le bruit de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne
se fasse connaître que dans l'assemblage confus de tous les autres ensemble, et qu'il
ne se remarquerait pas si cette vague qui le fait était seulee. Car il faut qu'on en soit
affecté un peu par le mouvement de cette vague et qu'on ait quelque perception de
chacun de ces bruits, quelque petits qu'ils soient ; autrement on n'aurait pas celle
de cent mille vagues, puisque cent mille riens ne sauraient faire quelque chose.
Aide à la lecture
a. Si une perception est sans aperception, c'est que nous n'en avons pas conscience.
b. L'harmonie de l'âme et du corps signifie que les affects de l'âme correspondent aux affects du corps.
c. « Des objets occupants » sont des choses qui concentrent l'intérêt et l'attention.
d. Il faut qu'un tiers intervienne sans attendre (incontinent) pour que le sujet prenne conscience d'une perception que l'oubli pourrait effacer.
e. De la même manière, lorsque l'on écoute un morceau de musique, on n'entend pas toutes les notes. Pourtant, elles existent pour former le morceau que l'on entend.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quels exemples de la vie courante illustrent nos « petites perceptions » ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le poids des pensées non conscientes
Leibniz affirme que nous avons des pensées non conscientes. Cette idée peut paraître paradoxale : penser, n'est‑ce pas justement avoir à l'esprit ce que l'on pense ? Pourtant nous avons tous fait une expérience qui illustre sa thèse : quand nous vivons près d'un lieu bruyant, nous « oublions » progressivement ce bruit. Nous avons toujours des petites perceptions des sons, mais plus d'aperception de ceux‑ci.
- Question : Devant l'impossibilité pour la conscience de saisir toute l'activité psychique, peut-on encore affirmer sa maîtrise ?
- Objectif : Envisager la portée des pensées non conscientes sur les choix que nous croyons faire librement. Si nos choix ne sont pas absolument déterminés, ne sont‑ils pas conditionnés à ces perceptions qui nous définissent aussi ? Si nous pensons sans savoir que nous pensons, quelle influence peuvent alors avoir ces pensées inconscientes sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Commentaire
Leibniz a lu Descartes, qui affirme que la conscience
se donne dans une intuition immédiate et que l'esprit
est ainsi plus facile à connaître que le corps. Il a également
lu Spinoza, selon lequel nous sommes conscients
de nos actes et de nos pensées, mais inconscients de
leurs causes. Avec cette idée que l'esprit est affecté de
petites perceptions non conscientes, Leibniz s'oppose à
Descartes et s'inscrit dans la même réflexion que celle
de Spinoza. Cette idée est reprise par les philosophes du
soupçon tels que Schopenhauer, Nietzsche ou encore le
psychanalyste Freud.
Ce texte de Leibniz repose sur une affirmation paradoxale : nous avons des perceptions que nous n'apercevons pas et des états mentaux que nous ne percevons pas. Comment cela est‑il possible ? Leibniz part de la constatation des faits : nous entendons le bruit d'une chute d'eau ou le ressac mais nous n'apercevons pas le bruit de chaque goutte, pourtant nécessaire au bruit final de l'eau qui tombe. Comment expliquer cela ? Le philosophe émet l'hypothèse que certaines perceptions, que nous devons forcément percevoir, sont tellement infimes, nombreuses, confuses ou coutumières que nous n'en avons pas conscience. Toutefois, comment peut-on ne pas avoir conscience de petites perceptions que nous percevons pourtant ? L'explication de Leibniz repose sur l'idée qu'il y a une harmonie entre l'âme et le corps, c'est‑à‑dire une unité qui fait que rien ne peut se passer dans le corps qui n'ait sa pensée correspondante dans l'âme, même si nous n'en prenons pas conscience.
Ainsi, par exemple, si une partie de notre corps est affectée par un mal, il y a nécessairement une pensée de ce mal dans notre âme, même si nous n'en avons pas une conscience claire. Il y a donc bien une unité psychosomatique (sôma signifie le corps en grec).
De ce fait, ce n'est pas parce que nous n'apercevons pas les petites perceptions qu'elles ne sont pas réelles. Elles doivent impérativement exister pour pouvoir produire ce bruit final que l'on perçoit. Pour qu'il y ait une conscience claire de ce bruit, il faut donc qu'il y ait des petites perceptions non conscientes, qu'il y ait d'abord de la perception sans que nous en ayons conscience. Ce sont des « perceptions insensibles », qu'on pourrait qualifier d'inconscientes.
Le mérite de Leibniz est de ne pas identifier la vie psychique à l'unique conscience, comme Descartes le pensait. Cependant, Leibniz définit les perceptions inconscientes comme une faille de la conscience, une limite dans ses capacités à se saisir des perceptions. Il ne s'agit donc pas encore de l'idée de l'inconscient freudien, doté d'une énergie et d'un dynamisme susceptibles d'affecter la vie psychique consciente.
Ce texte de Leibniz repose sur une affirmation paradoxale : nous avons des perceptions que nous n'apercevons pas et des états mentaux que nous ne percevons pas. Comment cela est‑il possible ? Leibniz part de la constatation des faits : nous entendons le bruit d'une chute d'eau ou le ressac mais nous n'apercevons pas le bruit de chaque goutte, pourtant nécessaire au bruit final de l'eau qui tombe. Comment expliquer cela ? Le philosophe émet l'hypothèse que certaines perceptions, que nous devons forcément percevoir, sont tellement infimes, nombreuses, confuses ou coutumières que nous n'en avons pas conscience. Toutefois, comment peut-on ne pas avoir conscience de petites perceptions que nous percevons pourtant ? L'explication de Leibniz repose sur l'idée qu'il y a une harmonie entre l'âme et le corps, c'est‑à‑dire une unité qui fait que rien ne peut se passer dans le corps qui n'ait sa pensée correspondante dans l'âme, même si nous n'en prenons pas conscience.
Ainsi, par exemple, si une partie de notre corps est affectée par un mal, il y a nécessairement une pensée de ce mal dans notre âme, même si nous n'en avons pas une conscience claire. Il y a donc bien une unité psychosomatique (sôma signifie le corps en grec).
De ce fait, ce n'est pas parce que nous n'apercevons pas les petites perceptions qu'elles ne sont pas réelles. Elles doivent impérativement exister pour pouvoir produire ce bruit final que l'on perçoit. Pour qu'il y ait une conscience claire de ce bruit, il faut donc qu'il y ait des petites perceptions non conscientes, qu'il y ait d'abord de la perception sans que nous en ayons conscience. Ce sont des « perceptions insensibles », qu'on pourrait qualifier d'inconscientes.
Le mérite de Leibniz est de ne pas identifier la vie psychique à l'unique conscience, comme Descartes le pensait. Cependant, Leibniz définit les perceptions inconscientes comme une faille de la conscience, une limite dans ses capacités à se saisir des perceptions. Il ne s'agit donc pas encore de l'idée de l'inconscient freudien, doté d'une énergie et d'un dynamisme susceptibles d'affecter la vie psychique consciente.

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 2« Quelque chose »
pense en moi
Texte fondateur
Pour Nietzsche, il existe des pensées qui viennent à l'esprit sans que nous l'ayons voulu. Il vaut donc mieux dire « quelque chose pense » plutôt que « je pense ».
En ce qui concerne la superstition du logicien, je ne me lasserai pas de souligner
un petit fait bref que ces superstitieux répugnent à avouer, à savoir qu'une
pensée vient quand elle veuta, et non quand « je » veux ; c'est donc falsifier les faits
que de dire : le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Quelque chose
pense, mais que ce quelque chose soit précisément l'antique et fameux « je »b, ce
n'est à tout le moins qu'une supposition, une allégation, ce n'est surtout pas une
« certitude immédiate »c. Enfin, c'est déjà trop dire que d'avancer qu'il y a quelque
chose qui pense : déjà ce « quelque chose » comporte une interprétation du processus
et ne fait pas partie du processus lui‑même. On déduit ici, selon la routine
grammaticale : « penser est une action, or toute action suppose un sujet agissant,
donc… » C'est par un syllogisme analogue que l'ancien atomisme ajoutait à la
force agissante ce petit grumeau de matière qui en serait le siège et à partir duquel
elle agirait : l'atomed ; des esprits plus rigoureux ont enfin appris à se passer de ce
« résidu de la terre », et peut‑être les logiciens eux aussi s'habitueront‑ils un jour
à se passer de ce petit « quelque chose », qu'a laissé en s'évaporant le brave vieux
« moi ».
Aide à la lecture
a. Nietzsche critique l'idée selon laquelle tout ce qui se passe dans le psychisme suivrait des règles grammaticales ou logiques.
b. Expression qui désigne le « je » pensant, donc la conscience réflexive de Platon à Descartes.
c. La pensée est un processus que l'on peut concevoir sans sujet.
d. Démocrite considérait que tout phénomène psychique ou matériel actif avait pour source une parcelle de matière : l'atome. Or, pour Nietzsche, l'atome n'est qu'une supposition.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Une forme de pensée peut‑elle exister sans référence au « je » pensant ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 3L'inconscient est une méprise sur le Moi
Alain veut bien reconnaître un inconscient du corps mais refuse, au nom de notre responsabilité
morale, l'idée que notre pensée puisse être déterminée indépendamment de la conscience.
a. Il n'y a qu'une altérité à la conscience, c'est le corps. Tout ce qui n'est pas strictement corporel est sous le contrôle de la volonté. Ainsi, nous devons répondre de toutes nos émotions et de tous nos gestes.
1. L'idolâtrie signifie ici : doter une chose matérielle d'une dignité psychique. C'est plus habituellement un culte infondé.
L'homme est obscur à lui-même, cela est à savoir. Seulement il faut ici éviter
plusieurs erreurs que fonde ce terme d'inconscient. La plus grave de ces erreurs
est de croire que l'inconscient est un autre Moi, un Moi qui a ses préjugés, ses
passions et ses ruses, une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. Contre quoi
il faut comprendre qu'il n'y a point de pensées en nous sinon par l'unique sujet,
Je ; cette remarque est d'ordre moral. Il ne faut pas se dire qu'en rêvant on se met
à penser. Il faut savoir que la pensée est volontaire, tel est le principe des remords :
« Tu l'as bien voulu ! » On dissoudrait ces fantômes en se disant simplement que
tout ce qui n'est point pensée est corps, c'est‑à‑dire chose soumise à ma volonté,
chose dont je réponds.a […] L'inconscient est donc une manière de donner dignité
à son corps. C'est une méprise sur le Moi, une idolâtrie1
On a peur de son inconscient, là se trouve logée la faute capitale. On croit qu'un autre Moi me conduit qui me connaît et que je connais mal. […] En somme, il n'y a pas d'inconvénient à employer couramment le terme d'inconscient, c'est un abrégé du mécanisme. Mais, si on le grossit, alors commence l'erreur, et, bien pis, c'est une faute.
On a peur de son inconscient, là se trouve logée la faute capitale. On croit qu'un autre Moi me conduit qui me connaît et que je connais mal. […] En somme, il n'y a pas d'inconvénient à employer couramment le terme d'inconscient, c'est un abrégé du mécanisme. Mais, si on le grossit, alors commence l'erreur, et, bien pis, c'est une faute.
Aide à la lecture
a. Il n'y a qu'une altérité à la conscience, c'est le corps. Tout ce qui n'est pas strictement corporel est sous le contrôle de la volonté. Ainsi, nous devons répondre de toutes nos émotions et de tous nos gestes.
Note de bas de page
1. L'idolâtrie signifie ici : doter une chose matérielle d'une dignité psychique. C'est plus habituellement un culte infondé.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
En quoi l'inconscient est-il un « abrégé du mécanisme », selon Alain ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
La naissance de la psychanalyse
Si la psychanalyse n'est pas une science de la nature, elle autorise néanmoins des interprétations tout à fait rationnelles qui visent à une meilleure compréhension de nous-mêmes.
Les Études sur l'hystérie, publiées en 1895 par Freud et son ami médecin Breuer, marquent la naissance de la psychanalyse. Dans cet ouvrage, les auteurs présentent une nouvelle méthode pour étudier et traiter les symptômes hystériques.
C'est dans ces Études qu'est évoqué pour la première fois le cas Anna O., pseudonyme de Bertha Pappenheim. Ce cas peut être considéré comme à l'origine du fondement de la psychanalyse, puisque Breuer et Freud comprendront que l'acte de parler peut guérir (talking cure) et constituer une sorte de catharsis, c'est-à-dire de purification.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 4Le cas Anna O.
Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Parler peut‑il guérir ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Concept / Image / Métaphore
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
Trouvez des exemples de situations qui montrent que quelque chose de nous-mêmes nous échappe.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille