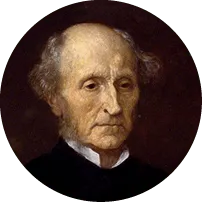Chapitre 13
Exercices
Faire une objection à un auteur
En vue de l'explication
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Méthode
Faire une objection consiste à nuancer la thèse de l'auteur. Il ne s'agit pas d'« instruire à charge », ni d'« attaquer » le texte dans le but de montrer qu'il est mal fondé ou mal argumenté.
Pour faire une objection, il est possible de :
- citer une autre philosophie dont les prémisses ou les développements divergent ;
- utiliser une comparaison historique entre l'époque du texte et la nôtre ;
- comparer des définitions d'un même concept pour montrer les écarts entre deux auteurs ;
- analyser les bases du raisonnement pour en faire ressortir les présupposés ;
- donner des exemples pertinents qui nuancent ceux de l'auteur.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Textes
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 10Le mensonge peut‑il être moralement justifié ?
Une déviation même involontaire de la vérité a de grandes conséquences ;
elle affaiblit la confiance qu'on accorde à la parole de l'homme, confiance sur
laquelle est basé tout bien‑être social actuel, et dont l'insuffisance fait plus que
toute autre chose pour retarder les progrès de la civilisation, de la vertu, de tout
ce qui est la base du bonheur humain. Nous sentons que violer une règle d'une si
grande utilité pour atteindre un avantage immédiat, n'est pas avantageux ; celui
qui, pour sa convenance personnelle ou celle d'un autre, fait ce qu'il peut pour
priver la société d'un bien et lui infliger un mal qui dépend du plus ou moins de
confiance que mettent les hommes dans la parole les uns des autres, agit comme
le pire de leurs ennemis. Cependant cette règle, même sacrée comme elle l'est,
admet des exceptions connues de tous les moralistes. La principale est celle‑ci :
quand l'empêchement d'un fait (comme la découverte d'un malfaiteur, ou l'annonce
de mauvaises nouvelles à un malade dangereusement atteint) doit préserver
quelqu'un (surtout autre que soi-même) d'un grand mal immérité, et que cet
empêchement est seul possible par ce moyen, on peut mentir. Mais pour que cette
exception ne s'étende pas, pour qu'elle affaiblisse le moins possible la confiance en
la vérité, on doit chercher à connaître et à définir ses limites.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 11À qui le mensonge cause‑t‑il du tort ?
Être véridique dans les propos qu'on ne peut éluder, c'est là le devoir formel de
l'homme envers chaque homme, quelle que soit la gravité du préjudice qui peut
en résulter pour soi‑même ou pour autrui. Et même si, en falsifiant mon propos,
je ne cause pas de tort à celui qui m'y contraint injustement, il reste qu'une
telle falsification, qu'on peut nommer également pour cette raison un mensonge
(même si ce n'est pas au sens des juristes), constitue, au regard de l'élément le plus
essentiel du devoir en général, un tort : car je fais en sorte, autant qu'il est en mon pouvoir, que des propos (des déclarations) en général ne trouvent aucun crédit et,
par suite, que tous les droits fondés sur des contrats deviennent caducs et perdent
toute leur force ; ce qui est un tort causé à l'humanité en général.
Donc, si on ne définit le mensonge que comme la déclaration (faite à autrui) qu'on sait n'être pas vraie, il n'est pas besoin d'y ajouter qu'il doive nuire à autrui, comme les juristes l'exigent de leur définition (« un mensonge est un discours faux qui nuit à autrui »). Car le mensonge nuit toujours à autrui : même s'il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à l'humanité en général et rend vaine la source du droit.
Donc, si on ne définit le mensonge que comme la déclaration (faite à autrui) qu'on sait n'être pas vraie, il n'est pas besoin d'y ajouter qu'il doive nuire à autrui, comme les juristes l'exigent de leur définition (« un mensonge est un discours faux qui nuit à autrui »). Car le mensonge nuit toujours à autrui : même s'il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à l'humanité en général et rend vaine la source du droit.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 12La vérité est un devoir circonstancié
Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de manière
absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans
les conséquences directes qu'a tirées de ce dernier principe un philosophe allemand
qui va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient
si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge
serait un crime. […] L'idée de devoir est inséparable de celle de droits : un devoir
est ce qui, dans un être, correspond aux droits d'un autre. Là où il n'y a pas de
droit, il n'y a pas de devoirs. Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui
ont droit à la vérité. Or nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.

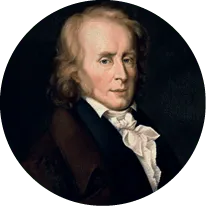
Constant - XIXe siècle
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercices
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 1
Texte 10.
a) Résumez le sens général de la doctrine utilitariste (voir Texte 2 ) : comment le bien est‑il défini ?
b) Quel sens donner au concept défini par le mot « avantageux » ici ?
c) Quelle règle sacrée Mill définit‑il ? Cherchez le sens de ce concept. Est‑il compatible avec une exception ?
d) Identifiez la réserve que Mill adresse à la fin du texte, concernant la thèse qu'il défend sur la possibilité de justifier le mensonge. En quoi cette réserve est-elle problématique pour l'utilitarisme en général ? Appuyez‑vous sur cette réponse et sur le texte de Kant pour formuler une remarque critique sur le texte de Mill.
e) Repérez les deux exemples que donne Mill pour justifier l'existence d'exceptions au devoir de véracité : réfléchissez à ce qu'ils peuvent avoir de discutable.
a) Résumez le sens général de la doctrine utilitariste (voir Texte 2 ) : comment le bien est‑il défini ?
b) Quel sens donner au concept défini par le mot « avantageux » ici ?
c) Quelle règle sacrée Mill définit‑il ? Cherchez le sens de ce concept. Est‑il compatible avec une exception ?
d) Identifiez la réserve que Mill adresse à la fin du texte, concernant la thèse qu'il défend sur la possibilité de justifier le mensonge. En quoi cette réserve est-elle problématique pour l'utilitarisme en général ? Appuyez‑vous sur cette réponse et sur le texte de Kant pour formuler une remarque critique sur le texte de Mill.
e) Repérez les deux exemples que donne Mill pour justifier l'existence d'exceptions au devoir de véracité : réfléchissez à ce qu'ils peuvent avoir de discutable.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 2
Texte 11.
a) Repérez les deux définitions du mensonge que Kant distingue dans le texte, et expliquez de quelle manière l'une englobe l'autre.
b) Quelle est la conséquence la plus grave de l'usage du mensonge pour Kant ? Vous pouvez vous appuyer sur le Texte 1
a) Repérez les deux définitions du mensonge que Kant distingue dans le texte, et expliquez de quelle manière l'une englobe l'autre.
b) Quelle est la conséquence la plus grave de l'usage du mensonge pour Kant ? Vous pouvez vous appuyer sur le Texte 1
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 3
Texte 10,
Texte 11.
Mill déclare que nous « sentons que violer une règle » est négatif, tandis que Kant invoque le « devoir formel » d'être véridique :
a) Expliquez en quoi ces deux formulations présentent une conception différente du problème moral du mensonge.
b) À partir de la conception kantienne, formulez une objection à l'encontre de la conception de Mill.
Mill déclare que nous « sentons que violer une règle » est négatif, tandis que Kant invoque le « devoir formel » d'être véridique :
a) Expliquez en quoi ces deux formulations présentent une conception différente du problème moral du mensonge.
b) À partir de la conception kantienne, formulez une objection à l'encontre de la conception de Mill.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 4
Texte 12.
a) Construisez une objection à Benjamin Constant en vous aidant du texte de Kant.
b) Listez les arguments qui vous pousseraient à mentir dans l'intérêt de l'autre.
c) Demandez à votre voisin de contredire vos arguments.
a) Construisez une objection à Benjamin Constant en vous aidant du texte de Kant.
b) Listez les arguments qui vous pousseraient à mentir dans l'intérêt de l'autre.
c) Demandez à votre voisin de contredire vos arguments.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille