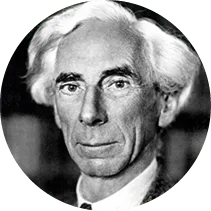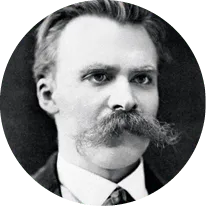Chapitre 15
Réflexion 3
La science s'oppose‑t‑elle à la religion ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 6La science s'oppose au dogmatisme
La nature même du « credo » religieux ne peut que s'opposer à la démarche scientifique.
Les credos sont la source intellectuelle du conflit entre la science et la religion, mais l'âpreté de la résistance a été due à leurs liens avec les Églises et les codes moraux. Ceux qui mettaient en doute les credos affaiblissaient l'autorité du clergé, et risquaient d'amoindrir ses revenus ; en outre, ils passaient pour saper la moralité,
puisque le clergé déduisait les devoirs moraux des credos. Il semblait donc
aux dirigeants temporels, tout comme aux gens d'Église, qu'ils avaient de bonnes raisons de craindre les doctrines révolutionnaires des hommes de science. [...]
Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère provisoire : elle s'attend à ce que des modifications de ses théories actuelles deviennent tôt ou tard nécessaires, et se rend compte que sa méthode est logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive.
Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère provisoire : elle s'attend à ce que des modifications de ses théories actuelles deviennent tôt ou tard nécessaires, et se rend compte que sa méthode est logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Croire / Savoir
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quelle différence essentielle sépare la théorie scientifique du credo religieux ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 7Croire n'est pas savoir
Texte fondateur
Croire et savoir ne se confondent pas, parce qu'ils ont chacun leur « ordre », c'est‑à‑dire leur domaine. Mais il ne s'agit pas de remplacer la croyance par la science. Il faut donc croire et savoir.
Le coeur a son ordre, l'esprit a le sien qui est par principe et démonstration. Le coeur en a un autre. On ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour ; cela serait ridicule. […]
La foi est différente de la preuve. L'une est humaine l'autre est un don de Dieu. Justus ex fide vivit1. C'est de cette foi que Dieu lui‑même met dans le cœura, dont la preuve est souvent l'instrument, fides ex auditu2, mais cette foi est dans le cœur et fait dire non Scio mais Credo 3. […]
Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment de cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés, mais ceux qui ne l'ont pas nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut.
La foi est différente de la preuve. L'une est humaine l'autre est un don de Dieu. Justus ex fide vivit1. C'est de cette foi que Dieu lui‑même met dans le cœura, dont la preuve est souvent l'instrument, fides ex auditu2, mais cette foi est dans le cœur et fait dire non Scio mais Credo 3. […]
Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment de cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés, mais ceux qui ne l'ont pas nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut.
Aide à la lecture
a. Le « cœur » désigne pour Pascal la faculté de connaître immédiatement les principes des choses, par le sentiment ou l'intuition.
Notes de bas de page
1. Les justes ne vivent que de la foi.
2. La foi issue d'une écoute.
3. Je ne sais pas, mais je crois.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Transcendant / Immanent
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
La foi peut‑elle être le résultat d'un raisonnement ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le pari pascalien
Faire l'apologie de la religion chrétienne ne signifie pas seulement en faire l'éloge, mais surtout la défendre contre ceux qui ne croient pas en elle, tels les libertins au XVIIe siècle. Or, Pascal est ici confronté à une double difficulté qu'il cherche à résoudre.D'une part, il constate que la foi n'a pas été donnée à tous les hommes et qu'il n'est pas possible de les forcer à croire en l'existence de Dieu.
D'autre part, les preuves de l'existence de Dieu ne sont bonnes que pour ceux qui croient déjà, notamment pour affermir leur foi, mais elles ne sauraient à elles seules convertir le non‑croyant. En effet, croire à l'existence de Dieu relève avant tout de l'ordre du cœur, et non de la raison. Le pari est l'argument pascalien pour inviter raisonnablement le non‑croyant à miser sur l'existence de Dieu, bien qu'il n'ait pas encore la foi et que les preuves de son existence lui resteront étrangères.
À celui qui refuserait de choisir, Pascal répond qu'il n'y a pas d'échappatoire au pari, parce que tout homme est « embarqué ». Ainsi, « il faut choisir ».
Comment choisir ? Il faut prendre pour critère la probabilité et l'utilité qui résulteraient de chaque option.
En pariant sur l'existence de Dieu, s'il existe, alors l'homme a tout à gagner pour sa vie actuelle et même future ; et s'il n'existe pas, il n'a rien à perdre puisqu'il n'y a pas de Dieu. À l'inverse, en ne pariant pas sur l'existence de Dieu, le risque de perdre, non seulement ce qui fait notre bien sur terre mais aussi l'accès à l'au‑delà, augmente. « Gagez donc qu'il est, sans hésiter ! ». Tout l'enjeu du pari consiste à proportionner les gains et les pertes à l'option choisie.

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 8Crainte et superstition
Spinoza entendait démontrer more geometrico, comme un théorème de géométrie, l'essence
et l'existence de Dieu. La superstition est le danger de toute croyance qui ne s'accompagne pas
de savoir.
1. La chance.
2. Bavardages.
Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté
ou encore si la fortune1 leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Mais souvent réduits à une extrémité telle qu'ils ne savent plus que résoudre, et condamnés, par leur désir sans mesure des biens incertains de fortune, à flotter presque sans répit entre l'espérance et la crainte, ils ont très naturellement l'âme encline à la plus extrême crédulité ; est‑elle dans le doute, la
plus légère impulsion la fait pencher dans un sens ou dans l'autre, et sa mobilité s'accroît encore quand elle est suspendue entre la crainte et l'espoir, tandis qu'à ses moments d'assurance elle se remplit de jactance2 et s'enfle d'orgueil.
Notes de bas de page
1. La chance.
2. Bavardages.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quelle est la place de l'orgueil dans la superstition ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
Faites une recherche sur la notion de concordisme. En quoi est‑elle une illustration de la relation entre la croyance et le savoir ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 9Le savoir cache une croyance
Conformément à sa démarche scientifique, le savant se garde de toute croyance. Et pourtant, il n'a pas conscience que sa démarche même repose sur une croyance plus profonde. Le savant est un croyant, parce qu'il croit en l'existence et en la valeur de la vérité, croyance puisée notamment
dans la religion.
a. La démarche scientifique consiste à rejeter toute conviction, c'est‑à‑dire toute croyance.
b. Toutefois, il y a lieu de soupçonner une croyance à l'origine de la démarche scientifique.
c. Le savant ne se doute même pas qu'il croit en la vérité. Pourquoi croire au vrai et pas au faux ?
d. Au fond, cette croyance du savant est métaphysique, parce qu'à l'origine elle remonte à la religion qui identifie Dieu et vérité.
e. Cependant, en prenant conscience de cette croyance des savants, il est possible de la remettre en cause.
1. Qui refuse une explication en dehors des lois de la physique.
En quoi nous aussi sommes encore pieux. – ans la science, les convictions n'ont pas droit de citéa , voilà ce que l'on dit à juste titre : c'est seulement lorsqu'elles s'abaissent au rang modeste d'une hypothèse, d'un point de vue expérimental provisoire, d'une fiction régulatrice, que l'on a le droit de leur accorder l'accès au royaume de la connaissance et de leur reconnaître même une certaine valeur, – toujours avec cette restriction de demeurer soumises à la surveillance policière, à la police de la méfiance. – Mais si l'on y regarde de plus près, cela ne signifie‑t‑il pas : c'est seulement lorsque la conviction cesse d'être conviction qu'elle peut parvenir à accéder à la science ? La discipline de l'esprit scientifique ne commencerait‑elle pas par le fait de ne plus s'autoriser de convictions ?… C'est vraisemblablement le cas : il reste seulement à se demander s'il ne faut pas, pour que cette discipline puisse commencer, qu'existe déjà une conviction, et une conviction si impérative et inconditionnée qu'elle sacrifie à son profit toutes les autres convictions ?b On voit que la science repose sur une croyance, qu'il n'y a absolument pas de science « sans présupposés »c.
Il ne faut pas seulement avoir déjà au préalable répondu oui à la question de savoir si la vérité est nécessaire, mais encore y avoir répondu oui à un degré tel que s'y exprime le principe, la croyance, la conviction qu'« il n'y a rien de plus nécessaire que la vérité, et que par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de second ordre ». – Cette volonté inconditionnée de vérité : qu'est‑elle ? Est‑ce la volonté de ne pas être trompé ? Est‑ce la volonté de ne pas tromper ? La volonté de vérité pourrait en effet s'interpréter aussi de cette dernière manière : à supposer que sous la généralisation « je ne veux pas tromper », on comprenne également le cas particulier « je ne veux pas me tromper ». Mais pourquoi ne pas tromper ? Mais pourquoi ne pas être trompé ? […] Mais on aura compris où je veux en venir, c'est‑à‑dire au fait que c'est toujours sur une croyance métaphysique que repose la croyance à la scienced, – que nous aussi, hommes de connaissance d'aujourd'hui, nous sans‑dieu et antimétaphysiciens 1, nous continuons d'emprunter notre feu aussi à l'incendie qu'a allumé une croyance millénaire, cette croyance chrétienne, qui était aussi la croyance de Platon, que Dieu est la vérité, que la vérité est divine… Mais si cette croyance précisément ne cesse de perdre toujours plus sa crédibilité, si rien ne s'avère plus divin, sinon l'erreur, la cécité, le mensonge, – si Dieu lui‑même s'avère être notre plus long mensonge ?e
Il ne faut pas seulement avoir déjà au préalable répondu oui à la question de savoir si la vérité est nécessaire, mais encore y avoir répondu oui à un degré tel que s'y exprime le principe, la croyance, la conviction qu'« il n'y a rien de plus nécessaire que la vérité, et que par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de second ordre ». – Cette volonté inconditionnée de vérité : qu'est‑elle ? Est‑ce la volonté de ne pas être trompé ? Est‑ce la volonté de ne pas tromper ? La volonté de vérité pourrait en effet s'interpréter aussi de cette dernière manière : à supposer que sous la généralisation « je ne veux pas tromper », on comprenne également le cas particulier « je ne veux pas me tromper ». Mais pourquoi ne pas tromper ? Mais pourquoi ne pas être trompé ? […] Mais on aura compris où je veux en venir, c'est‑à‑dire au fait que c'est toujours sur une croyance métaphysique que repose la croyance à la scienced, – que nous aussi, hommes de connaissance d'aujourd'hui, nous sans‑dieu et antimétaphysiciens 1, nous continuons d'emprunter notre feu aussi à l'incendie qu'a allumé une croyance millénaire, cette croyance chrétienne, qui était aussi la croyance de Platon, que Dieu est la vérité, que la vérité est divine… Mais si cette croyance précisément ne cesse de perdre toujours plus sa crédibilité, si rien ne s'avère plus divin, sinon l'erreur, la cécité, le mensonge, – si Dieu lui‑même s'avère être notre plus long mensonge ?e
Aide à la lecture
a. La démarche scientifique consiste à rejeter toute conviction, c'est‑à‑dire toute croyance.
b. Toutefois, il y a lieu de soupçonner une croyance à l'origine de la démarche scientifique.
c. Le savant ne se doute même pas qu'il croit en la vérité. Pourquoi croire au vrai et pas au faux ?
d. Au fond, cette croyance du savant est métaphysique, parce qu'à l'origine elle remonte à la religion qui identifie Dieu et vérité.
e. Cependant, en prenant conscience de cette croyance des savants, il est possible de la remettre en cause.
Notes de bas de page
1. Qui refuse une explication en dehors des lois de la physique.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Croire / Savoir
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
L'origine de la notion de vérité est‑elle d'ordre métaphysique ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Commentaire
Friedrich Nietzsche émet ici un soupçon radical sur
l'attitude du savant. Son raisonnement procède par un
enchaînement de questions. Le savant est-il bien celui
qu'il prétend être ? Est‑il bien cet homme qui repousse
ou suspend toutes ses convictions et croyances, qui pourraient
rendre partiel son jugement et l'invalider ? Ainsi, la
démarche scientifique consisterait à déposer toutes ses
croyances, le temps de la recherche, pour savoir la vérité.
Pourtant, il y a une croyance qui échappe au savant, lorsqu'il prétend se dépouiller de toutes ses croyances. En effet, Nietzsche pose une question d'ordre causal : qu'est‑ce qui déclenche la démarche scientifique ? C'est le fait que la vérité existe et que la vérité est nécessaire à connaître. Mais cela est tout autant une croyance. Le savant croit en la vérité.
Tel est donc le paradoxe, sinon la contradiction, de l'attitude scientifique. Elle prétend rejeter toute croyance et maintient cependant une croyance en la vérité. C'est au nom de cette croyance en la vérité que le savant abolit toutes ses autres croyances. Mais elle n'en reste pas moins une croyance. Nietzsche montre d'abord que le savant n'est pas celui qu'il prétend être. Ensuite, il remet en question la croyance en la vérité. Pourquoi ne pas plutôt croire en une divinité qui promeut le faux, le trompeur ? Pourquoi voulons‑nous la vérité ? La question est désormais d'ordre moral.
En conclusion, Nietzsche passe de la mise en question à la remise en cause de cette croyance en la vérité du savant, dans la mesure où elle puise sa source dans la religion. Nietzsche cible en particulier la religion chrétienne qui identifie Dieu et la vérité. On atteint donc Dieu lorsque l'on interroge la croyance en la vérité.
Si le savant est encore « pieux », c'est parce qu'il croit encore, et à son insu, en la vérité. Or, en croyant en la vérité, il croit encore en Dieu, alors même qu'il pourrait prétendre séparer religion et science, pour se ranger du côté de cette dernière. Certes, pour le savant, ce n'est pas tant Dieu qui est la vérité que la vérité qui est divine. Mais il reste pris dans la morale chrétienne de la vérité.
Nietzsche définit l'homme comme un « fabricateur de dieux » ; or la croyance dans la vérité est bien de cet ordre. Ainsi, selon l'auteur : « il y a dans le monde plus d'idoles que de réalités », ce qui signifie que la croyance en la vérité, n'est pas la seule idolâtrie présente dans le monde moderne. L'auteur en dresse une liste non exhaustive en citant : « progrès », « scientisme », « bonheur pour tous », ou encore « athéisme ». Ce dernier exemple peut surprendre, l'auteur s'en explique dans la Généalogie de la morale. Ce que souhaite l'athée c'est la vérité sans la foi en Dieu, or la croyance en la vérité est idolâtrie, l'athéisme est donc aussi une forme de foi en un idéal de vérité, « une phase dernière de son évolution ». Ibid.

Pourtant, il y a une croyance qui échappe au savant, lorsqu'il prétend se dépouiller de toutes ses croyances. En effet, Nietzsche pose une question d'ordre causal : qu'est‑ce qui déclenche la démarche scientifique ? C'est le fait que la vérité existe et que la vérité est nécessaire à connaître. Mais cela est tout autant une croyance. Le savant croit en la vérité.
Tel est donc le paradoxe, sinon la contradiction, de l'attitude scientifique. Elle prétend rejeter toute croyance et maintient cependant une croyance en la vérité. C'est au nom de cette croyance en la vérité que le savant abolit toutes ses autres croyances. Mais elle n'en reste pas moins une croyance. Nietzsche montre d'abord que le savant n'est pas celui qu'il prétend être. Ensuite, il remet en question la croyance en la vérité. Pourquoi ne pas plutôt croire en une divinité qui promeut le faux, le trompeur ? Pourquoi voulons‑nous la vérité ? La question est désormais d'ordre moral.
En conclusion, Nietzsche passe de la mise en question à la remise en cause de cette croyance en la vérité du savant, dans la mesure où elle puise sa source dans la religion. Nietzsche cible en particulier la religion chrétienne qui identifie Dieu et la vérité. On atteint donc Dieu lorsque l'on interroge la croyance en la vérité.
Si le savant est encore « pieux », c'est parce qu'il croit encore, et à son insu, en la vérité. Or, en croyant en la vérité, il croit encore en Dieu, alors même qu'il pourrait prétendre séparer religion et science, pour se ranger du côté de cette dernière. Certes, pour le savant, ce n'est pas tant Dieu qui est la vérité que la vérité qui est divine. Mais il reste pris dans la morale chrétienne de la vérité.
Nietzsche définit l'homme comme un « fabricateur de dieux » ; or la croyance dans la vérité est bien de cet ordre. Ainsi, selon l'auteur : « il y a dans le monde plus d'idoles que de réalités », ce qui signifie que la croyance en la vérité, n'est pas la seule idolâtrie présente dans le monde moderne. L'auteur en dresse une liste non exhaustive en citant : « progrès », « scientisme », « bonheur pour tous », ou encore « athéisme ». Ce dernier exemple peut surprendre, l'auteur s'en explique dans la Généalogie de la morale. Ce que souhaite l'athée c'est la vérité sans la foi en Dieu, or la croyance en la vérité est idolâtrie, l'athéisme est donc aussi une forme de foi en un idéal de vérité, « une phase dernière de son évolution ». Ibid.

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Croire en la vérité ?
Une partie du raisonnement nietzschéen reste implicite. Lorsqu'il pose la question du déclenchement de la démarche scientifique, l'auteur découvre que le savant a conservé une croyance en la vérité.- Question : Sans cette foi en la vérité, la démarche scientifique serait‑elle déclenchée ?
- Objectif : Montrer qu'une forme de religiosité, de croyance, est nécessaire pour entreprendre la démarche scientifique, ce qui n'empêche pas d'interroger ce point de départ par la suite.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille