Chapitre 2
Synthèse
La nature
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Introduction
La nature représente un enjeu moral et scientifique. D'un côté, la nature semble être une norme à l'aune de laquelle nous devrions juger, voire conformer notre existence. Mais d'un autre côté, la connaissance de la nature n'est pas entièrement affranchie de notre propre subjectivité ni de notre propre contexte socio-historique. Peut-on véritablement atteindre la nature indépendamment de toute culture ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Réflexion 1Peut-on mener une existence naturelle ?
- La nature doit-elle servir de modèle à une existence épanouie ?
- Est-il vraiment possible de vivre naturellement ?
L'artificialité de notre environnement culturel ainsi que l'hypocrisie de notre existence sociale font naître en nous des désirs, souvent frustrés, que nous n'aurions pas si nous vivions conformément à notre propre nature. Ne faut-il pas, pour vivre une vie à la fois heureuse et respectable, accepter la nature telle qu'elle est, comme nous y invite le stoïcisme ?
Être naturel se heurte à deux difficultés. D'un côté, quiconque souhaiterait devenir naturel, c'est-à-dire spontané et sans fard, se retrouverait dans une situation contradictoire puisqu'il chercherait à l'être de manière calculée et artificielle. D'un autre côté, Merleau-Ponty indique que tout dans l'homme semble résulter d'un entrecroisement entre nature et culture, si bien que renoncer à la culture reviendrait de fait à renoncer à tout ce que nous sommes.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Réflexion 2Avons-nous des devoirs envers la nature ?
- La nature n'est-elle pour l'homme qu'un simple « bac à sable » ?
- Quelle attitude éthique adopter envers la nature ?
Notre rapport à la nature se fait essentiellement par la technique. Alors que Descartes affirmait que la science devait nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature », notre attitude parasitaire se heurte aujourd'hui au problème de sa soutenabilité, et nous condamne à terme à faire disparaître le reste du vivant en même temps que nous-mêmes.
En même temps qu'un changement de perspective, faisant de l'être humain une exception dans la nature, l'homme doit inventer des devoirs moraux et même des règles juridiques nouvelles permettant de faire de la nature un véritable sujet de droit. Ainsi sera possible la réconciliation « symbiotique » de l'homme et du reste de la nature. C'est ce que souhaite Michel Serres lorsqu'il nous appelle à passer un « contrat naturel » avec la nature.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Réflexion 3La nature est-elle régie par des lois ?
- Les lois de la nature sont-elles une construction de la raison ?
- L'idée de nature est-elle universelle ?
Apparemment, l'observation de la nature semblerait permettre la formulation de lois, au moyen d'une analyse attentive des régularités dans les phénomènes naturels. Toutefois, notre expérience du réel en général, et de la nature en particulier, semble conditionnée par nos limites scientifiques et perceptives. Hume nous questionne : notre prétendue connaissance de la nature n'est-elle pas qu'une simple habitude perceptive et subjective ?
Malgré son évidence apparente, ce que nous appelons « nature » semble être la chose au monde la moins universellement partagée, ni dans le temps ni dans l'espace. N'est-elle pas une construction occidentale moderne ? Michel Foucault, en montrant comment l'histoire naturelle est née au XVIIe siècle, semble l'attester.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
L'essentiel est d'être ce que nous fit la nature ; on n'est toujours que trop ce que les hommes veulent que l'on soit.― Jean-Jacques Rousseau
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le véritable ordre de la Nature, c'est l'ordre que nous mettons techniquement dans la Nature.― Gaston Bachelard
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les désirs du pur homme naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux.― Charles Baudelaire
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
On devrait mieux respecter la pudeur avec laquelle la Nature se cache derrière des énigmes et des incertitudes chatoyantes.― Friedrich Nietzsche
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- La nature est-elle dégradée par la culture ?
- La nature est-elle donnée ou construite ?
- Peut-on être naturel ?
- L'homme occupe-t-il une place particulière dans la nature ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- John Stuart Mill, La Nature, 1874 •
- David Hume, Traité de la nature humaine, 1739
- Épicure, Lettre à Ménécée, IVe - IIIe s. av. J.-C.
- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755
- Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, 1948
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
À voir
-
Dominique Marchais, Nul homme n'est une île, 2017
Quelles initiatives citoyennes peuvent être menées pour repenser le bien commun autour de la nature et de son patrimoine ?

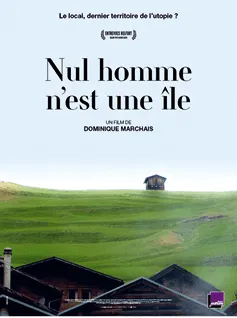
-
Matt Ross, Captain Fantastic, 2016
Peut-on vivre plus naturellement, en échappant à l'hypocrisie de la société et à l'artificialité de la culture ?

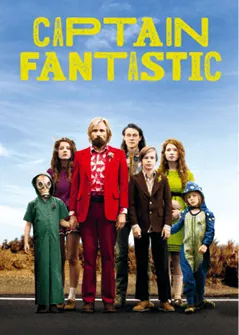
À lire
- Philippe Descola, Par-delà nature et culture, 2005
L'auteur, anthropologue, souhaite dépasser l'opposition stérile nature/culture et recherche d'autres approches pour caractériser la relation entre l'homme et son environnement. - Clément Rosset, L'Anti-Nature, 1973
Après avoir analysé les principales philosophies naturalistes et artificialistes, l'auteur présente l'idée de nature comme un fantasme et propose de lui préférer l'artifice.
-
Emanuele Coccia, La Vie des plantes, 2016
La société déconsidère le monde végétal, qui fournit pourtant l'oxygène nécessaire à sa vie. L'auteur prend le contre-pied de la tradition et fait de son étude des plantes une leçon de philosophie.
Liens avec les autres champs disciplinaires
-
Sciences économiques et sociales
- Siences de la vie et de la terre
- La domestication des plantes
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Retrouvez une .
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.


Retrouvez en classe pour réviser la notion de ce chapitre.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille


