Chapitre 15
L'art du détour
Religion, spiritualité, savoir
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Introduction
Se référant au bouddhisme, Siddhartha invite à penser la possibilité d'une spiritualité religieuse, sans dogmatisme ; il ne suit pas des préceptes mais découvre dans une expérience de vie, parfois douloureuse, un chemin spirituel.
Les stoïciens pratiquaient déjà un « exercice spirituel », selon l'expression de Pierre Hadot dans son ouvrage Qu'est‑ce que la philosophie antique ? Leur doctrine s'organise autour de l'idée de « vivre en accord avec la nature », laquelle s'identifie pour eux au monde, mais aussi à un dieu. L'âme doit ainsi s'exercer à être en harmonie avec la nature, harmonie qui est le guide d'une vie heureuse. Il s'agirait alors de penser la spiritualité comme une tentative de compréhension du monde comme totalité. C'est une idée qui n'est pas strictement bouddhiste, on en trouve un exemple occidental dans cette pensée de Marc Aurèle :
Les stoïciens pratiquaient déjà un « exercice spirituel », selon l'expression de Pierre Hadot dans son ouvrage Qu'est‑ce que la philosophie antique ? Leur doctrine s'organise autour de l'idée de « vivre en accord avec la nature », laquelle s'identifie pour eux au monde, mais aussi à un dieu. L'âme doit ainsi s'exercer à être en harmonie avec la nature, harmonie qui est le guide d'une vie heureuse. Il s'agirait alors de penser la spiritualité comme une tentative de compréhension du monde comme totalité. C'est une idée qui n'est pas strictement bouddhiste, on en trouve un exemple occidental dans cette pensée de Marc Aurèle :
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte
Penser sans cesse que le monde est un vivant unique, ayant une seule substance et
une seule âme, comment tout se rapporte à une conscience unique qui est la sienne,
comment il agit en tout par une impulsion unique ; comment tout concourt à tout
ce qui naît ; comment les choses sont tissées et enroulées ensemble.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Siddhartha, Hermann Hesse, 1922
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Dans une Inde bouddhiste, le récit de la vie de Siddhartha coïncide
avec sa longue quête du Savoir. En effet, Siddharta traverse une
crise existentielle et spirituelle dans sa jeunesse, qui l'amène à
quitter son village et à chercher le chemin de la compréhension
du monde. Il n'est pas satisfait par les brahmanes, ni les samanas,
ni même Gotama, le célèbre Bouddha et sa doctrine censée délivrer
de la souffrance. La réponse ne saurait être dogmatique. Il s'égare
alors dans les vices de la ville. Une nouvelle crise existentielle lui
fait prendre conscience de ses errances. Il subit un ultime événement
malheureux, la perte de son fils. C'est dans sa tristesse
ressassée qu'il parvient un jour à comprendre, alors qu'il regarde
son reflet dans l'eau du fleuve. Il entend le fleuve « rire », celui‑là
même d'où retentit la parole mystérieuse « Om », et dont l'écoulement
renvoie Siddhartha à lui-même, à sa propre vie fugace dans
le monde.

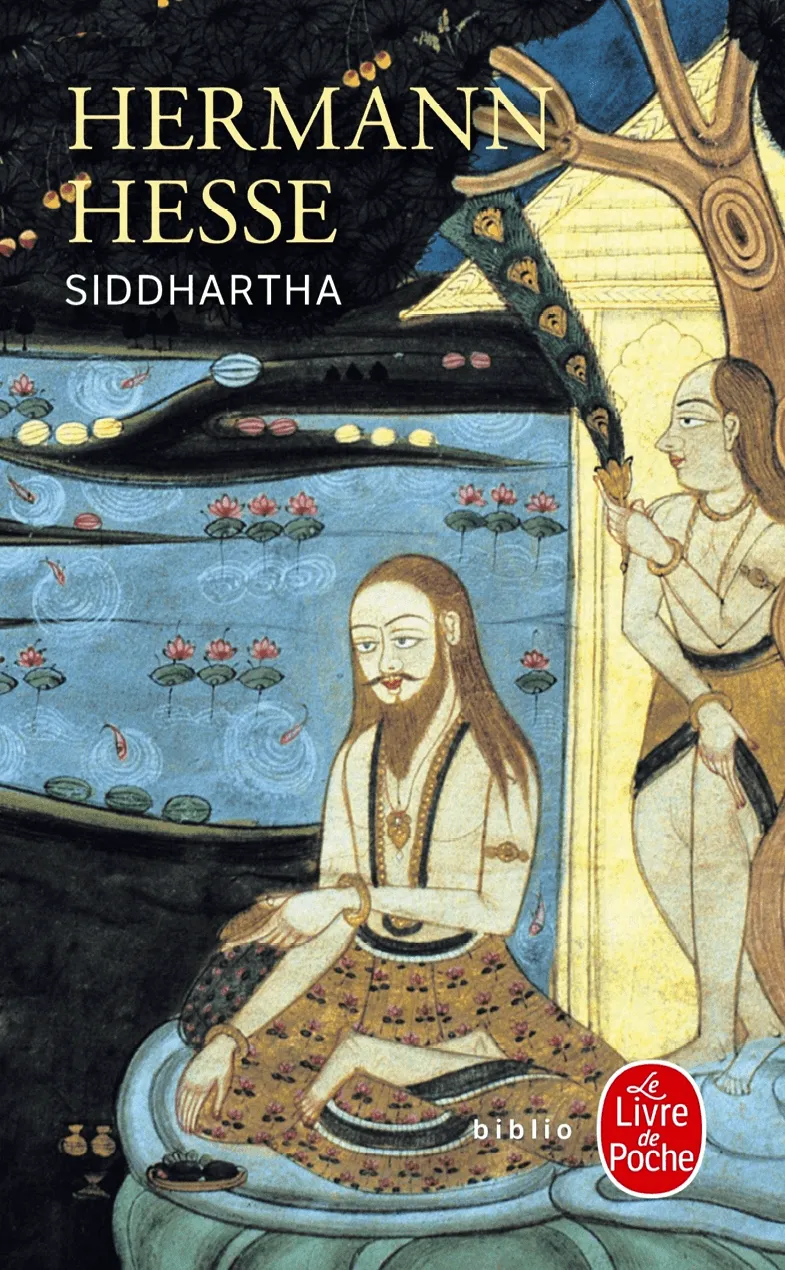
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
"Entends‑tu ?" Siddhartha faisait signe que oui. "Écoute mieux !" chuchota Vasudeva.
En quoi le développement de l'attention peut‑il favoriser la méditation ?
Le vieil homme Vasudeva et Siddhartha sont allés au bord du fleuve pour l'écouter. Ce n'est pas un bruit qu'ils espèrent entendre mais le chant de son écoulement. Vasudeva exhorte Siddhartha à écouter le fleuve.
Le vieil homme Vasudeva et Siddhartha sont allés au bord du fleuve pour l'écouter. Ce n'est pas un bruit qu'ils espèrent entendre mais le chant de son écoulement. Vasudeva exhorte Siddhartha à écouter le fleuve.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Siddhartha voyait comme il y courait, ce fleuve qui se composait de lui et des siens et de tous ceux qu'il avait connus.
Le fleuve devient l'objet de l'exercice spirituel. En celui‑ci, Siddhartha voit
défiler les images de sa vie, comme des reflets dans l'eau. Puis tout se
mélange. Les images se confondent pour ne faire qu'un. Et cet Un s'assimile
au fleuve même qui se met à « résonner ».
En quoi la nature peut‑elle devenir un objet religieux ?
En quoi la nature peut‑elle devenir un objet religieux ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Et toutes les voix, toutes les aspirations, toutes les convoitises, toutes les souffrances, tous les plaisirs, tout le bien, tout le mal, tout cela ensemble, c'était le monde.
Son oreille entend d'abord l'écoulement cyclique des désirs, puis les
souffrances et les plaisirs, dans le son cosmique du fleuve. Tout cela se
mélange à nouveau et Siddhartha prend conscience que cela est précisément
« le monde ».
Comment l'attention au monde se transforme‑t‑elle en méditation sur la réalité humaine ?
Comment l'attention au monde se transforme‑t‑elle en méditation sur la réalité humaine ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Alors il s'aperçut que tout l'immense concert de ces milliers de voix ne se composait que d'une seule parole : Om : la perfection.
Le monde lui apparaît comme le « fleuve de toutes les destinées accomplies » et « la musique de la vie ». Tout s'unifie dans « Om », c'est‑à‑dire
AUM, dont les trois lettres renvoient aux dieux Brahma (la naissance),
Vishnou (la vie) et Shiva (la mort), et qui condense le monde et le cycle de
la vie dans la profondeur d'un seul son.
Le monde est‑il une création divine harmonieuse ?
Le monde est‑il une création divine harmonieuse ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Sur son visage fleurissait la sérénité du Savoir auquel nulle volonté ne s'oppose plus, du savoir qui connaît la perfection, qui s'accorde avec le fleuve des destinées accomplies.
Siddhartha éprouve la joie d'être uni au Monde. Son Moi doit s'abstenir
d'agir pour savoir, il doit se laisser engloutir dans l'Un, faire partie du Tout
et de l'Un du Monde. Il atteint alors un savoir particulier qui lui permet
d'accepter le destin et de mettre fin à sa souffrance.
La religion délivre‑t‑elle un savoir ? Quelle en serait dès lors la vérité à connaître ?
La religion délivre‑t‑elle un savoir ? Quelle en serait dès lors la vérité à connaître ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Sa plaie s'épanouissait maintenant, sa souffrance rayonnait ; son Moi s'était fondu dans l'Unité, dans le Tout. Dès cet instant, Siddhartha cessa de lutter contre le destin ; il cessa de souffrir.
Entendant le mystérieux « Om », Siddhartha est apaisé. Sa souffrance est
toujours là, elle « rayonne » dit‑il, mais il ne souffre étrangement plus, car
il l'accepte désormais comme un destin.
La religion soigne‑t‑elle l'âme ? Ou n'est‑elle que le renoncement à l'individualité de l'âme ?
La religion soigne‑t‑elle l'âme ? Ou n'est‑elle que le renoncement à l'individualité de l'âme ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le Savoir peut se communiquer, mais pas la Sagesse.
Quelques pages plus tard, Siddhartha explique à son ami d'enfance
Govinda qu'il n'a pas de doctrine. Il n'a pas un savoir à enseigner. Pourtant,
il semble avoir fait l'expérience spirituelle d'un savoir nommé « Om ».
Siddhartha explique que le savoir qu'il a découvert est d'un type particulier :
il s'agit d'une sagesse qui ne se transmet pas comme telle, mais qu'il faut
vivre et chercher par soi‑même.
La spiritualité religieuse peut‑elle se transmettre ?
La spiritualité religieuse peut‑elle se transmettre ?
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille

