Chapitre 9
Synthèse
Le travail
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Introduction
Le travail est un enjeu individuel, social et politique fondamental. Il façonne notre identité – généralement, nous nous définissons par notre profession – et détermine notre place dans la société. Il nous permet d'acquérir des compétences et de nous perfectionner. Toutefois, sa pénibilité ne représente-t-elle pas une violence ? Le travail fait-il de nous des hommes ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Réflexion 1Le travail fait-il la valeur de l'homme ?
- Le travail est-il aliénant ?
Le travail n'est-il pas avant tout une dévalorisation et une dépossession de soi ? Par le travail, l'être humain s'aliène et, paradoxalement, peut s'appauvrir intellectuellement et physiquement. Lorsque le travail est répétitif, il ne permet plus de s'accomplir dans la mesure où il prive l'individu de l'objet qu'il a produit. Il en va ainsi du travailleur dans le système productif capitaliste décrit par Marx. - Quel perfectionnement de soi le travail permet-il ?
Cette aliénation par le travail est-elle inévitable ? À quelles conditions un travail peut-il permettre de s'accomplir et de se perfectionner ? Le travail ne serait pas seulement synonyme de dépossession mais donnerait sa valeur à l'homme : en développant ses facultés, en maîtrisant un geste ou un savoir-faire, le travail permettrait de donner un sens à sa vie – sens à comprendre à la fois comme une direction et une signification. Simone de Beauvoir reconnaît ainsi que le travail met l'homme face à son pouvoir. Cependant, cette fierté n'est-elle pas confisquée par le genre masculin ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Réflexion 2Perd-on sa vie en travaillant ?
- Tout travail est-il exploitation ?
Le travail permet-il de produire des richesses et de la valeur ou bien n'est-il au fond que la reconduction permanente de rapports d'exploitation ? Locke y voit la seule manière légitime d'acquérir la propriété, et Crawford en fait l'occasion de gagner en compétences et en estime de soi. Au-delà du travail nécessaire, ne faut-il pas, avec Russell, voir dans l'oisiveté l'occasion de produire des vertus morales et sociales ? - Que gagne-t-on à travailler ?
C'est parce que l'être humain travaille et qu'il transforme la nature autour de lui qu'il peut dire qu'une chose lui appartient. De ce point de vue, la propriété est la récompense de son travail. Cependant, cela suppose que l'organisation du travail ne soit pas précisément mise en place pour voler une partie du temps de travail. Or, le vol du surtravail est au coeur du mode de production capitaliste critiqué par Marx. Le travailleur fonde alors la propriété de celui qui l'exploite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Réflexion 3Le travail : nécessité ou libération ?
- L'homme peut-il se passer de travailler ?
Certes, l'homme est condamné à travailler puisqu'il doit satisfaire ses besoins. Le travail apparaît alors comme une souffrance qui s'abat sur l'homme. Faut-il diminuer le temps de travail ou faut-il avant tout changer l'organisation du travail ? Simone Weil le suggère, elle qui a voulu éprouver dans sa chair le travail harassant pour en penser le dépassement.
- Le travail n'est-il qu'une contrainte ?
Dans la mesure où il implique une peine à laquelle nous devons nous résoudre, dans tout travail il y a un élément de contrainte. Cependant, n'est-ce pas là qu'un aspect, partiel, du travail ? Ce dernier ne permet-il pas aussi de conquérir la liberté et le bonheur, pour peu qu'on laisse le travailleur cultiver « son propre champ » selon les termes d'Alain ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Tout travail travaille à faire un homme en même temps qu'une chose.― Emmanuel Mounier
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Dans le travail, l'homme n'est uni ni au monde ni aux autres hommes, seul avec son corps, face à la brutale nécessité de la vie.― Hannah Arendt
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
La tempérance et le travail sont les meilleurs médecins de l'homme.― Jean-Jacques Rousseau
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin.― Voltaire
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Que produit le travail ?
- Le travail paye-t-il toujours ?
- Le travail nous rend-il plus humain ?
- Est-il injuste d'exploiter le travail d'autrui ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Simone Weil, La condition ouvrière, 1937 •
- Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, 1958
- Karl Marx, Le capital, 1867-1894
- Karl Marx, Salaire, prix et plus-value, 1865
- Bertrand Russell, Éloge de l'oisiveté, 1935
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
À voir
- David Gelb, Jiro Dreams
of Sushi, 2012
Ce documentaire suit le travail de Jiro, un cuisinier japonais de 93 ans, dont le restaurant ne sert que des sushis. Précision du geste, patience et créativité du cuisinier sont autant de compétences valorisées dans son travail. Cette recherche de la perfection donne de la valeur à cet homme. Le sushi est source de satisfaction : objet quasiment précieux, esthétique, et en un sens, unique.

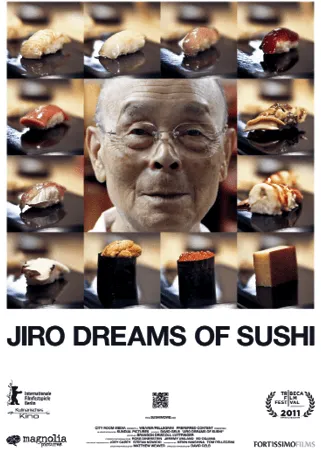
- Pierre Carles, Attention danger
travail, 2003
Ce documentaire donne à voir les mutations du management et nous livre le témoignage de ceux qui refusent le travail, s'opposant à la « valeur travail ».

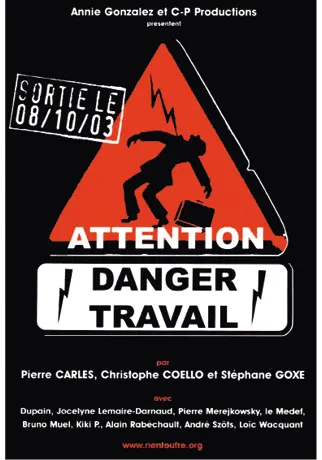
- Gérard Mordillat et Bertrand Rothé, Travail, salaire, profit, 2019
Cette série documentaire présente une série d'entretiens avec 21 chercheurs du monde entier qui interrogent les nouvelles réalités du travail contemporain.

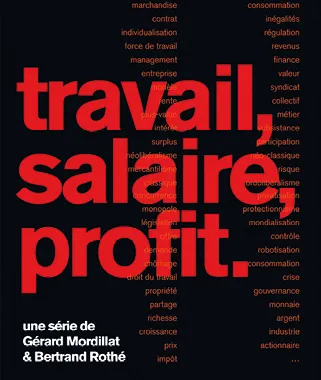
À lire
- Dominique Méda, Le Travail : une valeur en voie
de disparition, 1995
Dominique Méda pose la question de l'avenir de la « valeur travail » : comment les hommes et les femmes peuvent-ils penser le travail dans ses dimensions d'accomplissement personnel et de production de richesses économiques ? - David Graeber, Bullshit jobs, 2018
L'auteur identifie l'ordre économique et la mutation technologique du travail comme coresponsables d'une transformation des métiers en bullshit jobs. Il décrit ces activités infimes, répétitives, insensées et supervisées par une hiérarchie aussi multipliée qu'invisible.
Liens avec les autres
champs disciplinaires
-
Humanités, littérature et philosophie
L'humain et ses limites - Sciences économiques et sociales
- Histoire
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Retrouvez une anthologie complémentaire .
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.


Retrouvez en classe pour réviser la notion de ce chapitre.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille


