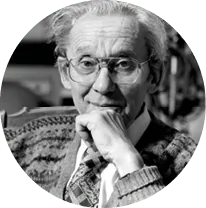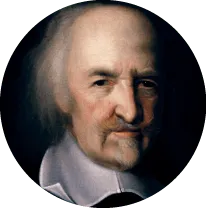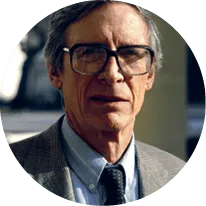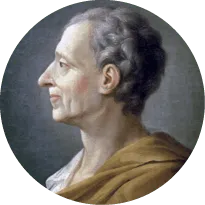Chapitre 12
Réflexion 2
À quelles conditions l'État est‑il légitime ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 5Le risque permanent de l'abus de pouvoir
L'État idéal est légitimé par ses valeurs universelles, mais l'incarnation réelle de l'État suppose
une contradiction avec son idéal.
a. Lorsque les citoyens s'en remettent à l'État pour exercer le pouvoir politique, celui‑ci leur devient en partie étranger (alienus signifie étranger en latin).
Toujours le souverain tend à escroquer la souveraineté ; c'est le mal politique essentiel. Aucun État n'existe sans un gouvernement, une administration, une police : aussi ce phénomène de l'aliénation politique traverse‑t‑il tous les régimes, à travers toutes les formes constitutionnellesa ; c'est la société politique qui comporte cette contradiction externe entre une sphère idéale des rapports de droit et une sphère réelle des rapports communautaires, et cette contradiction interne entre la souveraineté et le souverain, entre la constitution et le pouvoir, à la limite
la police. Nous rêvons d'un État où serait résolue la contradiction radicale qui existe entre l'universalité visée par l'État et la particularité et l'arbitraire qui l'affecte en réalité ; le mal, c'est que ce rêve est hors d'atteinte.
Aide à la lecture
a. Lorsque les citoyens s'en remettent à l'État pour exercer le pouvoir politique, celui‑ci leur devient en partie étranger (alienus signifie étranger en latin).
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Idéal / Réel
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quelle est la contradiction inscrite au cœur de toute société politique de forme étatique ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 6Ne servir que le bien du peuple
Pour Locke, l'exercice du pouvoir se restreint à la préservation des libertés attachées naturellement à l'individu.
a. Il est à noter que l'homme à l'état de nature est déjà, selon Locke, doté de raison, et qu'il dispose de libertés et de propriétés. Ces droits naturels ne doivent pas être abolis par la société civile, elle doit les garantir.
Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.
Aide à la lecture
a. Il est à noter que l'homme à l'état de nature est déjà, selon Locke, doté de raison, et qu'il dispose de libertés et de propriétés. Ces droits naturels ne doivent pas être abolis par la société civile, elle doit les garantir.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Quelles limites faut‑il fixer à l'autorité de la loi pour qu'elle serve le bien du peuple ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Le contractualisme
Le contractualisme est un courant de pensée de la philosophie politique moderne. Il se représente couramment l'État comme le résultat d'un contrat tacite d'association entre les citoyens. Les contractants quittent l'état de nature et fondent l'état civil.Les philosophes Hobbes, Rousseau et Locke sont des représentants du contractualisme, mais il existe de fortes divergences entre eux. Si le contrat est toujours la source de la légitimité de l'État et de son action, le fait que le gouvernement soit fondé sur un contrat peut être entendu en deux sens.
Le premier sens correspond au cas où les désavantages de la vie naturelle poussent des individus libres à passer un contrat législatif contraignant, mais protecteur.
Dans le second cas, des sujets passent un contrat avec un souverain qui restreint une part de leurs libertés par la loi ; ils disposent d'un droit de rompre le contrat si l'autorité ne sert plus le bien commun.
Les deux versions diffèrent donc selon le degré d'obéissance requis du citoyen et l'extension du périmètre de la légitimité de l'État.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 7L'État est un rempart contre la violence
Hobbes développe une théorie politique du contrat qui consiste à remettre à un souverain notre
liberté naturelle. L'État garantit la sécurité entre les citoyens en échange de la soumission de
tous ; il permet la naissance de la société civile qui est la seule susceptible de développer la
paix, la solidarité, et la vraie liberté.
a. Ici la république est la res publica : la constitution d'une communauté politique.
1. Qui ont la vertu suffisante pour entreprendre ou travailler.
Hors de la société civile chacun jouit d'une liberté très entière, mais qui est
infructueuse, parce que comme elle donne le privilège de faire tout ce que bon
nous semble, aussi elle laisse aux autres la puissance de nous faire souffrir tout ce
qu'il leur plaît. Mais dans le gouvernement d'un État bien établi, chaque particulier
ne se réserve qu'autant de liberté qu'il lui en faut pour vivre commodément, et
en une parfaite tranquillité, comme on n'en ôte aux autres que ce dont ils seraient
à craindre. Hors de la société, chacun a tellement droit sur toutes choses, qu'il ne
peut s'en prévaloir et n'a la possession d'aucune ; mais dans la républiquea, chacun
jouit paisiblement de son droit particulier.
Hors de la société civile, ce n'est qu'un continuel brigandage et on est exposé à la violence de tous ceux qui voudront nous ôter les biens et la vie ; mais dans l'État, cette puissance n'appartient qu'à lui seul. Hors du commerce des hommes, nous n'avons que nos propres forces qui nous servent de protection, mais dans une ville, nous recevons le secours de tous nos concitoyens. Hors de la société, l'adresse et l'industrie sont de nul fruit : mais dans un État, rien ne manque à ceux qui s'évertuent1 .
Hors de la société civile, ce n'est qu'un continuel brigandage et on est exposé à la violence de tous ceux qui voudront nous ôter les biens et la vie ; mais dans l'État, cette puissance n'appartient qu'à lui seul. Hors du commerce des hommes, nous n'avons que nos propres forces qui nous servent de protection, mais dans une ville, nous recevons le secours de tous nos concitoyens. Hors de la société, l'adresse et l'industrie sont de nul fruit : mais dans un État, rien ne manque à ceux qui s'évertuent1 .
Aide à la lecture
a. Ici la république est la res publica : la constitution d'une communauté politique.
Notes de bas de page
1. Qui ont la vertu suffisante pour entreprendre ou travailler.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Public / Privé
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Comment l'État peut‑il être le garant des droits particuliers ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
1. Établissez les critères qui permettraient de distinguer un régime illégitime d'un régime légitime.
2. Cherchez un exemple historique illustrant une autorité illégitime de l'État.
2. Cherchez un exemple historique illustrant une autorité illégitime de l'État.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 8La tutelle de l'État, nouvelle servitude ?
Texte fondateur
Pour Tocqueville, la démocratie est un état social historique marqué par l'effacement des distinctions fondées sur la naissance et l'origine sociale avant d'être un régime politique. Chacun a le droit d'accéder à toute activité ou responsabilité. Cependant, les peuples démocratiques développent une passion pour l'égalité qui les mène à négliger leur liberté : replié sur lui‑même et sur son souci du bien‑être, l'individu laisse à l'État la latitude de décider à sa place.
Je pense donc que l'espèce d'oppression, dont les peuples démocratiques sont
menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans le monde ; nos contemporains
ne sauraient en trouver l'image dans leurs souvenirs. […]
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux‑mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n'existe qu'en lui‑même et pour lui seul, et, s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patriea.
Au‑dessus de ceux‑là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouirb. […]
C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre ; qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui‑même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfaitc.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la fouled ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques‑unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout‑puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d'être en tutelle, en songeant qu'ils ont eux‑mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui‑même, qui tient le bout de la chaînee.
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. Je ne nierai pas cependant qu'une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentrée tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d'un homme ou d'un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle‑ci serait assurément la pire.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux‑mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n'existe qu'en lui‑même et pour lui seul, et, s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patriea.
Au‑dessus de ceux‑là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouirb. […]
C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre ; qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui‑même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfaitc.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la fouled ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques‑unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout‑puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d'être en tutelle, en songeant qu'ils ont eux‑mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui‑même, qui tient le bout de la chaînee.
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. Je ne nierai pas cependant qu'une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentrée tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d'un homme ou d'un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle‑ci serait assurément la pire.
Aide à la lecture
a. Les hommes investissent en priorité la sphère privée : leurs affaires et intérêts personnels ainsi que le cercle social des proches. Ils perdent le sens du bien commun et de l'intérêt général.
b. Le pouvoir prend en charge les citoyens, mais cette attention produit une tutelle : il décide avec eux, voire sans eux, du bien commun.
c. L'État habitue les hommes « à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté ».
d. La réduction de la volonté politique du citoyen s'accompagne d'une administration centralisée du pouvoir. Si un citoyen voulait agir politiquement, sa volonté serait éteinte par la multiplicité des procédures que l'État met en place.
e. Le citoyen d'un État démocratique est replié sur sa sphère privée, son indépendance est protégée par la loi. Il se désintéresse de la vie de l'État au point de vouloir l'asservissement, pourvu qu'il émane du peuple et qu'il concerne tous les citoyens.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
La confiance envers l'État est‑elle une vertu citoyenne ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte complémentaireLes régimes politiques et leur déviation
Il nous reste à examiner combien il y a de formes
diverses de gouvernement et quelles elles sont ; et d'abord
ceux qui sont bons, car quand nous les aurons définis, il
sera facile de reconnaître quels sont les gouvernements
qui n'en sont que des dérivations et des corruptions. Or,
puisque les mots république et gouvernement signifient
la même chose, puisque le gouvernement est l'activité
suprême dans les États, et que nécessairement cette autorité
suprême doit être dans les mains d'un seul, ou de
plusieurs ou de la multitude, il s'ensuit que lorsqu'un
seul, ou plusieurs, ou la multitude usent de l'autorité
conformément à l'utilité commune, il faut nécessairement
que ces gouvernants soient bons ; mais que ceux
qui n'usent du pouvoir que dans l'intérêt d'un seul, ou de
plusieurs ou de la multitude, sont des déviations de ces
bons gouvernements. Car il faut que l'on convienne, ou
que ceux qui en sont membres ne sont pas des citoyens,
ou qu'ils doivent participer à l'avantage général. Entre les
monarchies on donne communément le nom de royauté
à celle qui a pour but l'intérêt général. Le gouvernement
d'un petit nombre d'hommes ou de plusieurs et non
d'un seul, s'appelle aristocratie, soit parce que l'autorité
est entre les mains des meilleurs gens de bien, soit parce
qu'ils en usent pour le plus grand bien de l'État et de tous
les membres de la société. Enfin, lorsque la multitude
gouverne dans le sens de l'intérêt général, on donne à
cette forme de gouvernement le nom de république, qui
est commun à toutes les autres formes. […]
Les gouvernements qui sont des déviations ou des dégénérations de ceux que nous venons de nommer sont : par rapport à la royauté, la tyrannie ; par rapport à l'aristocratie, l'oligarchie ; et par rapport à la république, la démocratie. En effet la tyrannie est une monarchie gouvernée dans l'intérêt du monarque ; l'oligarchie est dirigée dans le seul intérêt des riches, et la démocratie dans le seul intérêt des pauvres ; mais aucun de ces gouvernements ne s'occupe de l'utilité ou de l'avantage de la société tout entière.
Les gouvernements qui sont des déviations ou des dégénérations de ceux que nous venons de nommer sont : par rapport à la royauté, la tyrannie ; par rapport à l'aristocratie, l'oligarchie ; et par rapport à la république, la démocratie. En effet la tyrannie est une monarchie gouvernée dans l'intérêt du monarque ; l'oligarchie est dirigée dans le seul intérêt des riches, et la démocratie dans le seul intérêt des pauvres ; mais aucun de ces gouvernements ne s'occupe de l'utilité ou de l'avantage de la société tout entière.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 9La désobéissance civile est un acte civique
Il appartient au citoyen de protester, sans violence, contre une loi ou un exercice du pouvoir
qui lui semble illégitime.
La désobéissance civile peut, tout d'abord, être définie comme un acte public, non
violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent
pour amener à un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement.
En agissant ainsi, on s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté
et on déclare que, selon son opinion mûrement réfléchie, les principes de la coopération
sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement respectés. […]
La désobéissance civile est non violente [car elle] exprime la désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi, bien qu'elle se situe à sa limite extérieure. La loi est enfreinte, mais la fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et non violente de l'acte, par le fait qu'on est prêt à assumer les conséquences légales de sa conduite. [Elle] se situe donc entre la protestation légale et le déclenchement de procès exemplaires, d'une part, et l'objection de conscience et les diverses formes de résistance, d'autre part.
La désobéissance civile est non violente [car elle] exprime la désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi, bien qu'elle se situe à sa limite extérieure. La loi est enfreinte, mais la fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et non violente de l'acte, par le fait qu'on est prêt à assumer les conséquences légales de sa conduite. [Elle] se situe donc entre la protestation légale et le déclenchement de procès exemplaires, d'une part, et l'objection de conscience et les diverses formes de résistance, d'autre part.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Légal / Légitime
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Pourquoi la désobéissance civile doit‑elle être publique et non violente ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 10La séparation des pouvoirs
Texte fondateur
Montesquieu invite à ne pas réunir dans les mains de la même personne, ou institution, les trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Faute de respecter cette règle, le pouvoir devient oppresseur et potentiellement tyrannique.
Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la
puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ;
parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des
lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative, et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseura.
Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative, et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseura.
Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Aide à la lecture
a. Si le pouvoir exécutif détient le pouvoir de faire la loi et celui de juger, aucun contrôle de ses décisions et de ses actions n'est possible.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
En quoi consistent les abus du pouvoir ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
La solidarité peut‑elle être un délit ?


Cédric Herrou est condamné le 8 août 2017 à quatre mois de prison avec sursis pour aide à
l'immigration clandestine après avoir conduit, hébergé et nourri des centaines de migrants
clandestins qui tentaient de traverser la frontière italo-française. L'éleveur affirme « faire le
travail de l'État » puisque « c'est le rôle d'un citoyen d'agir lorsqu'il y a défaillance de l'État ».
Les actions de Cédric Herrou sont considérées par beaucoup comme de la désobéissance civile. Chacun ne pourrait-il pas ainsi, lorsqu'il commet un délit, invoquer ce concept ? Comment situer la limite entre délit et désobéissance ?
Les actions de Cédric Herrou sont considérées par beaucoup comme de la désobéissance civile. Chacun ne pourrait-il pas ainsi, lorsqu'il commet un délit, invoquer ce concept ? Comment situer la limite entre délit et désobéissance ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 11Trois sources de légitimité
Pour Max Weber, l'État exerce une domination grâce au monopole de la violence légitime. L'auteur identifie ici les trois fondements de cette légitimité.
a. Le pouvoir pourrait user de la violence directement mais, s'il veut gouverner efficacement, il doit dominer, c'est‑à‑dire justifier ses décisions et l'usage de la violence en se référant à une légitimité admise.
b. L'autorité s'appuie donc sur trois formes de légitimité : traditionnelle, charismatique, et légale. La forme moderne appuie sa légitimité sur la légalité institutionnelle et la croyance en une compétence des dirigeants.
Comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé historiquement, l'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime (c'est‑à‑dire sur la violence qui est considérée comme légitime). L'État ne peut donc exister qu'à la condition que les hommes dominés se soumettent à l'autorité revendiquée chaque fois par les dominateursa. […]
Il existe en principe, nous commencerons par là, trois raisons internes qui justifient la domination, et par conséquent il existe trois fondements de la légitimité. Tout d'abord l'autorité de l'« éternel hier », c'est‑à‑dire celle des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l'habitude enracinée en l'homme de les respecter. Tel est le « pouvoir traditionnel » que le patriarche ou le seigneur terrien exerçaient autrefois. En second lieu l'autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu (charisme) ; elle se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d'un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu'elle se singularise par des qualités prodigieuses, par l'héroïsme ou d'autres particularités exemplaires qui font le chef. C'est là le pouvoir « charismatique » que le prophète exerçait, ou – dans le domaine politique – le chef de guerre élu, le souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef d'un parti politique. Il y a enfin l'autorité qui s'impose en vertu de la « légalité », en vertu de la croyance en la validité d'un statut légal et d'une « compétence » positive fondée sur des règles établies rationnellement, en d'autres termes l'autorité fondée sur l'obéissance qui s'acquitte des obligations conformes au statut établib. C'est là le pouvoir tel que l'exerce le « serviteur de l'État » moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s'en rapprochent sous ce rapport.
Il existe en principe, nous commencerons par là, trois raisons internes qui justifient la domination, et par conséquent il existe trois fondements de la légitimité. Tout d'abord l'autorité de l'« éternel hier », c'est‑à‑dire celle des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l'habitude enracinée en l'homme de les respecter. Tel est le « pouvoir traditionnel » que le patriarche ou le seigneur terrien exerçaient autrefois. En second lieu l'autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu (charisme) ; elle se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d'un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu'elle se singularise par des qualités prodigieuses, par l'héroïsme ou d'autres particularités exemplaires qui font le chef. C'est là le pouvoir « charismatique » que le prophète exerçait, ou – dans le domaine politique – le chef de guerre élu, le souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef d'un parti politique. Il y a enfin l'autorité qui s'impose en vertu de la « légalité », en vertu de la croyance en la validité d'un statut légal et d'une « compétence » positive fondée sur des règles établies rationnellement, en d'autres termes l'autorité fondée sur l'obéissance qui s'acquitte des obligations conformes au statut établib. C'est là le pouvoir tel que l'exerce le « serviteur de l'État » moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s'en rapprochent sous ce rapport.
Aide à la lecture
a. Le pouvoir pourrait user de la violence directement mais, s'il veut gouverner efficacement, il doit dominer, c'est‑à‑dire justifier ses décisions et l'usage de la violence en se référant à une légitimité admise.
b. L'autorité s'appuie donc sur trois formes de légitimité : traditionnelle, charismatique, et légale. La forme moderne appuie sa légitimité sur la légalité institutionnelle et la croyance en une compétence des dirigeants.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Question
Les trois sources de la légitimité sont‑elles de valeur équivalente ? Pourquoi ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Activité
Trouvez des exemples historiques de désobéissance civile, puis discutez‑en la portée civique. Vous pouvez comparer la légitimité du pouvoir et celle de la désobéissance à ce pouvoir.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille