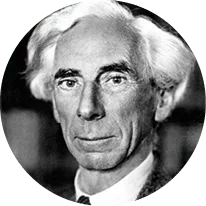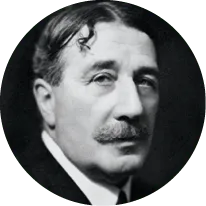Chapitre 4
Exercices
Expliquer en reformulant
En vue de l'explication
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Méthode
Pourquoi expliquer ?
L'explication consiste à faire comprendre un fait, une idée ou une relation en les rendant compréhensibles aux autres et à soi-même. Comme le rappelle l'étymologie, expliquer revient à déplier (explicare en latin), c'est-à-dire à enlever les plis d'une chose, qu'on tente de comprendre en la déployant.
Comment expliquer un mot ?
- En désignant les caractéristiques de la chose à expliquer au moyen d'adjectifs qualificatifs. Par exemple, la raison est rationnelle et raisonnable.
- En ajoutant des propositions subordonnées qui articulent les qualités identifiées de ce mot. Par exemple, la raison, qui permet de résoudre des problèmes moraux et logiques, etc.
- En utilisant des antonymes. Par exemple, manquer de raison, c'est être irrationnel et déraisonnable.
Comment expliquer une difficulté ?
- En identifiant si la difficulté vient d'une confusion entre deux termes ou vient d'un présupposé.
- En identifiant si la difficulté vient d'une relation manquante entre des concepts.
- En reformulant le style d'un texte trop dense ou sans conjonctions de coordination.
- En proposant des hypothèses de lecture.
- En vérifiant la cohérence entre vos hypothèses de lecture et le reste du texte.
En expliquant, nous vérifions que nous maîtrisons réellement ce que nous affirmons, en essayant de rendre notre pensée accessible à toute autre pensée rationnelle.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Textes
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 11Le désir est-il irrationnel ?
Certaines personnes ont l'impression que si un désir d'ordre général, disons le
désir du bonheur de l'humanité, n'a pas la sanction du bien absolu, il est en quelque
sorte irrationnel. Cela tient à un reste de croyance à l'objectivité des valeurs.
Un désir ne peut être ni rationnel ni irrationnel par lui‑même. Il peut s'opposer à d'autres désirs, et rendre malheureux ; il peut soulever une opposition chez les autres, et être impossible à satisfaire. Mais il ne peut pas être considéré comme « irrationnel » uniquement parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on le ressent. Nous pouvons désirer A parce que A mène à B, mais au bout du compte, quand nous en avons fini avec les moyens, nous arrivons forcément à quelque chose que nous désirons sans raison, mais non pas « irrationnellement » pour autant.
Tous les systèmes de morale incorporent les désirs de ceux qui les prônent, mais ce fait est caché par un brouillard de mots. Nos désirs sont en réalité d'ordre plus général et moins purement égoïstes que bien des moralistes ne l'imaginent ; s'il n'en était pas ainsi, aucune morale théorique ne rendrait le progrès moral possible.
Un désir ne peut être ni rationnel ni irrationnel par lui‑même. Il peut s'opposer à d'autres désirs, et rendre malheureux ; il peut soulever une opposition chez les autres, et être impossible à satisfaire. Mais il ne peut pas être considéré comme « irrationnel » uniquement parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on le ressent. Nous pouvons désirer A parce que A mène à B, mais au bout du compte, quand nous en avons fini avec les moyens, nous arrivons forcément à quelque chose que nous désirons sans raison, mais non pas « irrationnellement » pour autant.
Tous les systèmes de morale incorporent les désirs de ceux qui les prônent, mais ce fait est caché par un brouillard de mots. Nos désirs sont en réalité d'ordre plus général et moins purement égoïstes que bien des moralistes ne l'imaginent ; s'il n'en était pas ainsi, aucune morale théorique ne rendrait le progrès moral possible.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte 12Penser, c'est dire « non »
Penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui est d'un homme qui
s'endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur ? Ce n'est que l'apparence. En tous ces cas-là, c'est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l'heureux acquiescement. Elle se sépare d'elle‑même. Elle combat contre elle‑même. Il n'y a pas au monde d'autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c'est que je consens, c'est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c'est que je respecte au lieu d'examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence. C'est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercices
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 1
Texte 11.
a) En quoi cet extrait est-il déjà par lui-même un travail d'explication ? Quelles opérations effectue-t-il successivement ? Quels liens pouvez-vous identifier entre ces opérations ?
b) Selon vous, reste-t-il encore un point du texte à expliquer ?
Pourquoi ? Rédigez un petit paragraphe pour le rendre compréhensible
aux autres.
a) En quoi cet extrait est-il déjà par lui-même un travail d'explication ? Quelles opérations effectue-t-il successivement ? Quels liens pouvez-vous identifier entre ces opérations ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 2
Texte 12. Ce texte est typique d'une écriture dense. L'expliquer, c'est faire apparaître ses articulations implicites et sa
logique. Lisez-le deux fois, puis répondez aux questions.
a) Quel type de phrase l'auteur choisit-il d'employer au d�ébut du texte ? Pourquoi ce choix va-t-il déterminer la suite du texte ? Selon vous, quel est l'intérêt de cette stratégie argumentative ?
b) « Elle rompt l'heureux acquiescement. Elle se sépare d'ellemême. Elle combat contre elle-même ». De quoi ces phrases sont-elles l'explication ? À quelle logique d'ensemble obéissent-elles ? Formulez ces phrases de manière plus explicite et plus développée.
c) « Il n'y a pas au monde d'autre combat ». Donnez une justification à cette déclaration. Quelle autre partie du texte justifie cette affirmation ?
d) En quoi la dernière phrase est-elle une conclusion ?
e) Résumez le cheminement de l'auteur sous la forme d'un arbre dont les branches expliquent les voies suivies mais aussi celles qui ont été abandonnées.
a) Quel type de phrase l'auteur choisit-il d'employer au d�ébut du texte ? Pourquoi ce choix va-t-il déterminer la suite du texte ? Selon vous, quel est l'intérêt de cette stratégie argumentative ?
b) « Elle rompt l'heureux acquiescement. Elle se sépare d'ellemême. Elle combat contre elle-même ». De quoi ces phrases sont-elles l'explication ? À quelle logique d'ensemble obéissent-elles ? Formulez ces phrases de manière plus explicite et plus développée.
c) « Il n'y a pas au monde d'autre combat ». Donnez une justification à cette déclaration. Quelle autre partie du texte justifie cette affirmation ?
d) En quoi la dernière phrase est-elle une conclusion ?
e) Résumez le cheminement de l'auteur sous la forme d'un arbre dont les branches expliquent les voies suivies mais aussi celles qui ont été abandonnées.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 3
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Exercice 5
Texte 4 , Texte 5 et Texte 6.
Expliquez la distinction entre l'être et l'existence, en vous appuyant sur les textes mentionnés ci-dessus et en variant les procédés utilisés (par exemple, en partant de la définition de leurs antonymes, en dépliant les sens possibles des termes, en essayant de trouver un troisième terme pour distinguer les deux précédents).
Expliquez la distinction entre l'être et l'existence, en vous appuyant sur les textes mentionnés ci-dessus et en variant les procédés utilisés (par exemple, en partant de la définition de leurs antonymes, en dépliant les sens possibles des termes, en essayant de trouver un troisième terme pour distinguer les deux précédents).
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille